Californie apocalyptique, de Salvation Mountain à Joshua Tree-
C’est la Californie des laissés pour compte, l’envers brûlé du décor de cinéma. C’est un road trip solitaire un peu sinistre, une virée dans une Californie désertique, toxique et abandonnée. Sur les rives empoisonnées du Salton Sea, dans les décombres de Salvation Mountain où errent les junkies, partons au pays de l’apocalypse. A Joshua Tree seulement, nous retrouverons un peu de beauté….
blog salvation mountain – blog salton sea – blog joshua tree – visiter salvation mountain – aller à salvation mountain – lieux de tournage into the wild californie

Salvation Mountain.
Road trip halluciné dans le désert de Californie
Fin septembre 2016, je suis partie pour un long road trip en Californie, seule. A ce moment-là, j’avais besoin de cette solitude radicale, de ce « juste moi et la route ». La première partie de mon séjour a été littorale et radieuse : San Diego, La Jolla, Oceanside, Laguna Beach. Puis j’ai bifurqué vers l’intérieur, vers le comté de Riverside, et la désolation s’est abattue sur moi.
J’ai longtemps hésité à publier ce texte très noir et assez personnel, écrit à chaud, durant le séjour. Ce texte est très différent de ce que je publie d’habitude sur Itinera Magica, beaucoup plus pessimiste et introspectif. Mais au fond, j’avais envie de le partager avec vous. Un an plus tard, voici donc le récit de mon incursion au pays des anges tombés. Je n’ai rien censuré – ceci est du texte brut, écrit le soir dans les motels, au cœur du désert californien.
Si vous débarquez sur ce blog pour la première fois, ne commencez pas par cet article.

.
L’empire de la désolation
Au moment de quitter Laguna Beach pour plonger dans le cœur désertique de la Californie, je me demande vraiment ce que je fous, et quel génie tordu du marketing a réussi à me convaincre qu’aller voir des cailloux et des bidonvilles mérite de renoncer à la sublime route côtière 101. J’aurais probablement annulé la partie dustbowl si je n’avais pas déjà payé l’hôtel à Indio.

Laguna Beach – difficile de renoncer à ça.
La route que j’emprunte n’est pas pour me rassurer. A moins de cinq miles de la mer déjà, le paysage entre en phase terminale. Je n’ai jamais vu ça de ma vie : une telle désolation. Je traverse Irvine, puis Riverside, dans un état de sidération catastrophée. Tout est mort. Tout. Cela n’a rien à voir avec ce que j’ai vu en Arizona, un désert alerte, rempli de cactus et de succulentes, grouillant de vie tenace et bien adaptée à l’aridité. Certes, le désert du Mojave a toujours été plus âpre et brutal que le désert de Sonora, dont l’Arizona fait partie – mais ce que je vois dépasse le particularisme topologique. Ces villes ont été fondées sur des sources, ici les troupeaux venaient paître, ici la vie avait droit de cité : l’histoire des villes du désert en Californie, c’est celle du miracle de l’eau, de zones épargnées par la sécheresse. Et pas même une seule vache ne pourrait survivre dans le décor apocalyptique que je traverse aujourd’hui. Partout autour de moi, pas un arbre, pas un buisson vivant sur les collines de la sierra, juste un manteau pelé d’herbe morte, brune, où rien n’a survécu. C’est comme si le paysage tout entier avait été scalpé. Et cette pelade de brindilles irrémédiablement sèches, c’est du combustible parfait. Je repense aux incendies titanesques qui ont ravagé la Californie depuis deux ans. Je me souviens de ce que disait un chef des pompiers : que chaque nouvel incendie rentrait directement au top 10 des plus cataclysmiques, que les records du nombre d’hectares brûlés ne cessaient d’être battus, que le feu avait changé de comportement et était impossible à contenir, sautant de colline en colline comme une armée démoniaque, enjambant les coupe feux, irrépressible, terrifiant. Qu’ils avaient l’impression de mener une guerre contre un ennemi infiniment plus fort qu’eux. Des dizaines de pompiers sont morts cet été, piégés par des feux qui se reformaient soudain en muraille, comme une marée infernale qui revient au galop – ce feu-là n’est plus du ressort humain. Il est chez lui. Le sol est ravagé, toute l’eau douce a été pompée, et une année 2016 riche en pluies (à cause d’El Nino) n’a rien pu y changer. La Californie est en train de crever.
Je m’attendais à trouver un peu plus de verdure à Palm Springs et dans la vallée de Coachella. En vérité, les collines sont tout aussi mortes, mais au fond des vallées, l’irrigation fait jaillir de terre des plantations de palmiers à huile et d’autres plantations compatibles avec l’aridité, dessinant des paysages d’oasis qui me font penser à Al Ain.

.

.
Depuis les années 50, Palm Springs est la retraite chic des Angelinos qui décident d’arrêter leurs antidépresseurs et vont cuver leur phase psychotique au bord d’une piscine dans le désert. J’ai cherché dans tous les sens « que faire à Palm Springs », mais on ne me conseille que des spas, des cliniques de détox et des restaurants prétentieux dont l’alcoolisme mondain est le fonds de commerce. Alentours, c’est un morne mange-poussière. Les tuyaux d’irrigation énormes traînent partout, enlisés dans cinquante centimètres de sable. C’est le pays de Steinbeck.

Sur les traces d’Into the wild : Salton Sea, le pire de la Californie
Mon immersion dans l’envers du décor californien, je la dois à une scène de film. Dans Into the wild, le héros (qui va finir par crever dans un bus en Alaska après avoir malencontreusement mangé une racine qui détruit son estomac) commence son roadtrip en Californie et échoue au milieu du désert du Mojave, au pied d’une montagne psychédélique peinte à la gloire de Dieu. Salvation mountain. C’est elle qui m’obsède depuis, et c’est à cause d’elle que j’ai quitté Laguna Beach pour me taper trois heures de route dans ce no man’s land. A ce moment précis, je me jure de renoncer au cinéma. Je me dis que c’est bien la seule chose sur laquelle je suis d’accord avec les salafistes, le cinéma c’est le diable. J’ai presque envie de retourner à Palm Springs m’inscrire en détox des films masochistes qui te donnent des idées de merde. Mais j’avale la poussière jusqu’à la lie et je continue vers le pire du pire : le Salton Sea, probablement l’endroit le plus irrémédiablement moche et mort de l’Ouest.

Salton Sea.
Aucun lieu n’incarne mieux le désastre environnemental californien que le plus grand lac de l’Etat, le Salton Sea : près de 1000km carrés d’eau empoisonnée. Le Salton Sea est né d’un accident. En 1905, le creusement d’un système d’irrigation ouvre une brèche dans le lit du fleuve Colorado, et déverse des millions de litres au cœur du désert, dans une dépression rocheuse qui se remplit. L’inondation sera endiguée deux ans plus tard, mais les eaux d’irrigation continueront d’approvisionner le Salton Sea, créant un « lac miracle » au cœur du Mojave, qui aimante les foules. Dans les années 50, les Américains, qui étaient encore dans cette phase mégalo où ils pensaient que l’homme pouvait coloniser Mars et que les cigarettes étaient bonnes pour la santé, ont décidé d’en faire un endroit à la mode. Des stations lacustres ont ouvert, les yachts abondaient sur les eaux scintillantes, les stars venaient en villégiature, achetaient des maisons sur les rives du lac. Et puis soudain, dans les années 70, le Salton Sea s’est mis à mourir. Les rejets issus de l’agriculture dans la vallée de Coachella l’ont empoisonné et entraîné une eutrophisation extrême. Le lac est devenu un cloaque puant, biologiquement mort, où plus rien ne vit, aucun animal, aucune autre plante que cette vase méphitique à l’agonie qui envahit l’air. Le Colorado continue de nourrir le Salton Sea. De loin, les reflets du soleil sur ses mille kilomètres carrés nourrit l’illusion de la joliesse. De près, on porte la main à la gorge, on cherche un foulard pour se couvrir. Un lac mort au milieu de collines mortes. Le néant. Certains disent qu’il faudrait dérouter à nouveau le Colorado, laisser le Salton Sea se dessécher et mourir pour de bon. On leur répond que les effluves toxiques risqueraient de tuer toutes les personnes qui vivent dans la région.

.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, quelques communautés vivent encore au bord du lac dantesque. C’est un paysage indescriptiblement dérangeant. Tout a été laissé en plan, des stations essences abandonnées depuis les années 70, des restaurants et hôtels en ruine, des visions post-apocalyptiques au milieu desquelles des hommes continuent pourtant de vivre – mobil homes, baraques miséreuses de bric et de broc, desservies par des bus scolaires jaunes, incarnation même du déni. Salton Sea State Park, préparez-vous à payer, indique un panneau qui affiche les tarifs. Mais la guérite est désertée. Sur l’immense terrain de camping, il n’y a plus que deux caravanes, des voyageurs un peu paumés qui lisent les panneaux d’un air hébêté. Locations de kayak et de bateaux, promet un autre. Mais la marina n’est plus qu’un lit de vase noire. Personne n’a enlevé les panneaux du club de yachting, qui est devenu une espèce de centre social, et continue de prétendre à une activité nautique morte depuis longtemps. Les hommes ici vivent au milieu de cadavres en feignant de les croire en vie. Comme si le Salton Sea pouvait ressusciter, comme si quelqu’un allait rouler la pierre. Les trains de la Pacific company roulent sur l’immense voie ferrée qui traverse le royaume de l’illusion, d’immenses trains de marchandises venus du Canada, acheminant au cœur de la misère toute la richesse qu’elle voit scintiller comme un mirage. Je vois ce que je n’aurais jamais dû voir.

.

.
Les palmiers-éventail de Californie
Je voulais accéder à l’oasis Dos Palmas, probablement une des dernières choses à voir dans la région du Salton Sea. Je savais que la route n’était pas carrossée sur les trois derniers miles, mais cela ne me perturbait pas trop : j’avais fait toute l’Apache trail sans 4×4 en Arizona. Mais en arrivant au début du chemin, je comprends aussitôt qu’il me faudra renoncer. La route est défoncée et ensablée au-delà du supportable, et seul un véhicule de rallye pourrait s’y engager. Rester embourbée dans cette région sans réseau et sans aucun passage, où marcher deux fois trois miles dans le désert avec une bouteille d’Evian de 0,5 L pour seul viatique, ne me paraissent que moyennement souhaitables. Je n’oublie pas qu’à l’été 2015, une famille française a été décimée à Whitesands, Nouveau Mexique. Partis pour une randonnée réputée facile, mais avec trop peu d’eau, les deux parents se sont effondrés après avoir laissé les dernières gouttes à leur fils de huit ans, que les rangers ont retrouvé recroquevillé, brûlé, déshydraté, mais vivant, auprès des cadavres de ses parents. C’est quelque chose que les Européens ont tendance à oublier : que la terre, ici, peut dévorer les hommes.
Comme pour me récompenser de ma sagesse, les palmiers que j’espérais voir à Dos Palmas surgissent miraculeusement le long de la route, quelques miles plus tard. Ce sont les « California fan palms », ces palmiers majestueux qu’on trouve dans les oasis de Californie et nulle part ailleurs au monde. Les résurgences d’eau douce dans le sol aride font surgir leurs hauts troncs en éventail, si typiques, si caractéristiques. Ceux-là ont manifestement su trouver quelque source le long du Salton Sea, et je les accueille avec la joie de l’enfant qui découvre un Kinder surprise dans une décharge.

.

.
Niland, la ville des laissés pour compte
Je continue à longer les rives du lac zombie, vers la Salvation mountain. Enfin j’arrive à Niland, la ville fantôme où elle se trouve. Là encore, c’est la désolation. Motels et restaurants abandonnés, ouverts à tous les vents, rues envahies de poussière gluante, comme si quelque pandémie monstrueuse s’était abattue sur la ville. Et là encore, des gens vivent pourtant, les plus pauvres des pauvres, dans des espèces de camps de réfugiés sédentarisés, des baraques sordides et des campings cars, autour de jardins de sable remplis de Jésus effrités et de guirlandes de Noël. Je n’ai jamais rien vu d’aussi grimaçant. Je ne m’arrête même pas pour faire des photos, parce que j’ai la trouille. C’est le pays des morts vivants.
C’est aussi à Niland qu’on trouve Slab City, « la dernière ville libre des Etats-Unis », campement des marginaux, des squatteurs, des gens en rupture avec le monde. Il y aura peut-être des gens pour raconter que c’est cool, alternatif, positif. Moi je vois des gens défoncés au regard vide et à l’avenir qui se reflète dans le Salton Sea.
Et enfin, que dans le jour descendant, je vois surgir la Salvation mountain.

.
Salvation Mountain, le pèlerinage des junkies
Soudain je ne regrette plus mon incursion dans le ventre du néant. C’est une colline multicolore, née de bétons et de ferraille agglomérés, qui semble peinte sous ecstasy, et où trône le message God is love, décliné de mille façons. Des camions abandonnés, peints en mille couleurs, arborent des versets bibliques. Au sein de la montagne, on trouve des grottes psychédéliques, de petites chapelles avec des Vierges Maries qui ont perdu leur tête, et un immense arbre peint en rose et vert, une sorte d’arbre de vie mystique pour hippies illuminés. Je rentre dans le cœur de Dieu. Salvation mountain est digne d’ébranler même un athée : c’est une des plus belles, des plus touchantes expressions de l’art naïf et du mysticisme que je connaisse. Je vais de chambre en chambre au creux de la montagne, fascinée. Salvation mountain est l’œuvre de Leonard Knight qui à l’âge de quarante ans a connu une crise mystique, et dévoué sa vie à l’édification de cette folie de foi, témoignage d’une religiosité brute – l’amour, la rédemption – rétive à toute institutionnalisation. Jusqu’à sa démence en 2011 (il meurt en 2014), il a entretenu la montagne. Aujourd’hui, l’association de ses amis a pris le relai, et des gens viennent poser leur campement dans le désert, avec leurs pots de peinture et leurs rouleaux, et entretenir l’œuvre unique. L’un d’eux veille sur le site, avec ses trois chiens, un petit soldat de Dieu au milieu du Mojave, qui repeint un flanc de colline.

.

.

.

.

.

.
Peu de voyageurs visitent Salvation mountain, si loin de tout, mais il y a groupe de trois baroudeurs en survêtement douteux, deux jeunes et un vieux, qui me racontent être sur les routes depuis un an, et vouloir se poser quelques jours à Slab City. Ils me proposent un joint, une pipe de crack, ou de coucher avec l’un des trois (ou avec tous, c’est selon). Je décline avec ma politesse désormais habituelle et songe que si ça dégénère, j’irai me réfugier auprès du soldat de Jésus avec ses trois molosses. Mais ils acceptent mon refus avec une résignation gracieuse. Depuis que je suis seule en Californie, on m’a proposé toutes les drogues et tout le kamasutra. Je réponds non merci comme s’il s’agissait d’une tasse de thé.

.

.

.

.
Une fois le soleil couché, je retourne vers la vallée de Coachella, le seul endroit où on trouve des motels – aucun hébergement n’est plus proposé sur les rives du Salton Sea. Je dors à Indio dans un motel étonnamment convenable, et me mets en route tôt le matin vers le parc national de Joshua Tree, à une cinquantaine de kilomètres à l’Est. Parmi les grands parcs nationaux de l’Ouest, Joshua Tree est souvent délaissé, car il est excentré, à l’écart de toutes les routes habituelles de road trip – ce qui explique que je sois si souvent venue dans l’Ouest des Etats-Unis sans l’avoir vu encore. Cela fait plusieurs années que j’en rêve. Plus encore que la Salvation mountain, c’est lui qui justifiait la virée désertique.

Joshua Tree
Les cactus de Joshua Tree
Je rentre dans le parc au sud, par Cottonwood, et au début, l’inquiétude me saisit : le paysage n’a pas changé. Toujours cette moquette de trucs morts, ces cailloux sans rédemption. Puis peu à peu, la vie revient. La zone orientale du parc appartient déjà au désert de Sonora, et je retrouve les cactus d’Arizona : les ocotillos, qui ressemblent à de longues tiges mortes en période de sécheresse, et reverdissent et fleurissent aussitôt que la pluie tombe, les chollas, des espèces de nounours épineux qui se jettent sur les passants pour transporter leurs graines ailleurs. Les cactus du désert de Sonora, je les connais désormais par cœur, je me les suis fichés dans les pieds, les mains, les fesses et toute autre partie charnue de mon anatomie, j’ai lu tous les bouquins, vu tous les jardins botaniques, je suis incollable, et peux expliquer crânement à une Allemande que ça, c’est pas du tout une cholla, enfin, c’est un prickle pear. Je me sens dans mon élément.

Cholla.


.

Ocotillo
Puis la zone Sonora s’achève, retour dans le Mojave, et c’est de nouveau la désolation. Les panneaux s’excusent : en raison du changement climatique, il n’y a plus d’arbres de Josué dans cette partie du parc, mais continuez vers le nord, enfoncez-vous dans le parc, vous allez les trouver. Je comprends que la zone de vie des arbres magiques rétrécit toujours davantage, qu’ils se terrent au cœur du parc comme des bêtes traquées.
La première fois que j’ai vu un Joshua tree, c’était à l’été 2015, quelque part à proximité du Grand Canyon. J’avais été fascinée par la beauté de ces grands yuccas dégingandés qui semblaient tendre mille bras désespérés vers le ciel – une créature d’oraison, à qui on a multiplié les mains pour qu’elle puisse mieux implorer son Dieu. J’avais appris ensuite que c’était exactement la raison pour laquelle les premiers pèlerins les avaient nommés Joshua trees, ce qui m’avait vaguement inquiétée : j’ignorais avoir le même imaginaire qu’un puritain du 19e paumé dans le désert. Aujourd’hui, la silhouette des arbres de Josué me paraît plus poignante encore : leur prière est une supplique pour la survie. Ils sont pour moi devenus le symbole de cette Californie suppliciée, à bout de souffle. Les panneaux racontent que Joshua Tree était un jardin d’éden, le havre des troupeaux, qu’au XIXe siècle, les vallées secrètes cachées derrière les rideaux de rochers abritaient de verts pâturages. Il n’en reste pas une trace.
Wonderland of rocks : l’âme du granit
C’est quand j’arrive au campement de Whitetank que je vois les premiers surgir. Encore petits, encore chétifs. Mais la forêt de Joshua trees commence. Ainsi que l’autre merveille du parc national, ce qu’on nomme le « wonderland of rocks » : le pays magique des rochers. Le titre n’est pas usurpé. Des monolithes énormes, spectaculaires, déploient des formes lunaires, rondeurs pleines ou émondées, doigts tendus en bouquet au-dessus des fissures, arches à demi écroulées, champs d’énormes galets lisses et polis ou mystère des formes capricieuses. Je pense aussitôt aux Seychelles, aux blocs de granit rassemblés sur les plages comme autant de dinosaures assoupis. L’exposition géologique valide l’analogie : il s’agit bien du même phénomène.



.

.

.
Nombre de gens pensent que les rochers de Joshua Tree sont du même matériau que les mesas de Monument Valley ou Sedona, que les grottes fantastiques d’Antelope Canyon : du grès, sandstone en anglais, accumulation de sédiments sableux qui ont formé les hauts plateaux de la région du Grand Escalier. Mais en réalité, il ne s’agit ici pas de grès, mais de granit.
Le granit est l’enfant abandonné des plaques qui divorcent. Il forme une couche profonde du manteau terrestre, d’ordinaire cachée sous des centaines de mètres d’autres couches, loin de nos yeux. Mais là où la tectonique fendille l’écorce, là où les mouvements de subduction laissent les roches profondes à nu, le granit apparaît. Aux Seychelles, c’est parce que lors de l’éclatement du Gondwana, les îles sont restées seules au milieu de l’océan, vestiges résiduels du cataclysme, orphelines de la dérive des continents, dont elles révèlent le visage abyssal. A Joshua Tree, c’est parce que la faille de San Andreas court au fond de la vallée – on la voit depuis le point de vue des Keys, le sommet du parc, monstrueuse, terrifiante, la matrice des catastrophes qui un jour déchiquèteront la Californie. Ici la plaque américaine et la plaque pacifique divergent, et le granit, poussé par des forces colossales, remonte mutilé, brisé par les mâchoires tectoniques – d’où ces formes délirantes, ces courbes qui trahissent de très anciennes bulles de magma, ces arrêtes qui révèlent la cassure, et que l’érosion continue d’affiner. Le paysage de Joshua Tree est un rescapé de la nuit des temps. Et je suis submergée par une émotion profonde. Au milieu du peuple d’arbres suppliants, je vois le cœur de la Terre, et l’écrasante majesté des millénaires. C’est beau, beau, déchirant, ces forêts de yuccas immenses, ces amoncellements de roches à qui le crépuscule dessine des ombres solennelles, ces ciels du désert que le soir plonge dans un délire de rouges et de mauves. Joshua Tree me bouleverse.

.

.

.
Etre une rockstar au Joshua Tree Inn
Je dors dans un motel suffisamment mythique pour ne pas être sur Booking ou Tripadvisor, le Joshua Tree Inn. Dans les années 60, tout ce que Los Angeles comptait de rockstars venait se réfugier ici, dans cet endroit qui stimule infiniment l’imagination créatrice, et dormait au bord de la piscine du Joshua Tree Inn. Les Rolling Stones y ont composé nombre de leurs chansons. Gram Parsons y est mort d’une overdose ; à mon arrivée, la réceptionniste me propose gentiment d’occuper sa chambre, mais je décline, et choisis celle d’une musicienne et pin-up, Emylou Harris. L’endroit possède un charme incroyable, une espèce d’emporium du rock’n’roll, avec force vinyles et posters dédicacés, affiches des 60’s, déco dans son jus, mémorial à Gram Parsons en forme de guitare, et cette piscine au fond trouble, bordée de Joshua trees, au bord de laquelle somnolent des bikers sexagénaires. La playlist qui résonne dans le jardin de cactus et de glycines est impeccable, un pur délice rétro. J’adore ce lieu.

.

.
Joshua Tree, artistes et soldats
Le village de Joshua Tree n’a rien à voir avec la désolation de Niland. C’est ici un refuge choisi et non subi, un endroit roots et brut de décoffrage, plein de bars à la tronche improbable et de magasins à la dégaine de saloon, mais bien vivant. Pioneertown a été fondée en 1946 par des investisseurs hollywoodiens qui rêvaient de créer un décor de cinéma à ciel ouvert, une ville comme dans les années 1870, fidèle à l’esthétique de la frontière. Et les gens sont venus prendre possession de la maquette. On sent que les habitants aiment ce lieu, les arbres fantomatiques qui poussent dans leurs jardins, la mémoire de la Terre et le souvenir des 60’s, on sent qu’ils sont venus ici de leur plein gré, pour habiter pleinement cet endroit hors-normes, se baigner de son énergie. Il paraît que les artistes continuent de venir créer ici, que des stars partent deux semaines en retraite désertique et reviennent la guitare saturée de chansons. Et surtout, il y a tous les militaires stationnés à la base toute proche de 29 Palms, venus s’entraîner dans le désert qui ressemble un peu à ceux d’Afghanistan ou d’Irak avant d’y partir pour de vrai… et leurs femmes esseulées venues faire la fête pour oublier l’angoisse du coup de fil. Le village de Joshua tree palpite.
On me conseille le bar-resto Pappy’s and Harriet’s Palace, le bar mythique du coin. L’ambiance est hyper chaleureuse, un décor de western bondé de gens qui s’amusent, et la nourriture est extra. Les gens sont chaleureux et m’invitent à leur table. C’est soirée karaoké à Pappy’s and Harriet’s, et mes nouveaux amis américains, le fait d’être à 9000 kilomètres de toute personne que je serais susceptible de revoir, et le massacre de Walk of life par un dénommé Rooster (poulet) m’engagent à me jeter à l’eau pour la première fois de ma vie. Je me lance donc sur Ziggy Stardust de Bowie, et je préfère ne pas savoir ce que les gens en ont pensé – surtout qu’après moi passe une nana au look incroyable, ronde et belle, couverte de tatouages et de piercings, qui rugit un Don’t stop believing magistral. Les gens dans ce bar sont un défilé de mode alternative, et j’ai l’impression de voir les fringues que ma mère portait dans les années 70-80 ressorties de la cave et assorties de façon hasardeuse.

.

.
Questions existentielles au coin du feu
A mon retour au Joshua Tree Inn, je trouve près du feu de jardin deux couples qui étaient à la soirée karaoké, et qui me hèlent « eh Ziggy Stardust, viens t’asseoir avec nous » ! Ils ont mon âge, l’âge où on a merdé sa vingtaine, ne sait pas trop où on en est de sa vie et part pour des virées dans le désert avant d’atteindre une trentaine sans gloire. On se dit qu’à nos âges, nos parents avaient des carrières, des plans de vie ambitieux, qu’ils étaient lancés. Nous avons fait des études passionnantes et sans issue et nous sommes des jeunes gens intelligents, cultivés et complètement inutiles à une société qui a de moins en moins besoin de main d’œuvre humaine. Nous ne croyons en rien, si ce n’est peut-être à l’amour. Les deux couples ont voyagé ensemble pendant un moment, depuis la Nouvelle-Orléans et les bayous de Louisiane (qu’ils me décrivent comme l’endroit le plus fabuleux qu’ils connaissent), et leurs chemins se séparent maintenant, car l’un d’eux part demain pour Vegas. Ils veulent se marier dans la Valley of fire. En attendant, ils dorment dans la chambre où Gram Parson a clamsé. L’autre va rester quelques jours à Joshua Tree. Elle est musicienne, elle rêve que l’ambiance incroyable du désert fasse jaillir d’elle l’album tant espéré. Ils me proposent un joint, mais pas de pipe de crack, ni de sexe. Du coup, je suis vexée et je refuse.

Partir.
La nuit sur Joshua Tree
Vers deux heures du matin, avant d’aller me coucher, je retourne une dernière fois au cœur du parc. Les arbres de Josué se lamentent sous fond de constellations. Au milieu des troncs desséchés et du granit qui rappelle l’imminence des catastrophes tectoniques, j’ai comme l’impression d’un adieu. Je me dis que c’est peut-être la dernière fois que je viens en Californie, avant qu’elle s’ouvre en deux. Je dis au revoir aux pèlerins et aux scarabées, aux guitares et aux monolithes, et je m’endors les yeux ouverts sur les galaxies.

.
Un de ces quatre, je vous parlerai de Laguna Beach et de Santa Monica, ça sera plus joyeux. En attendant, les articles à venir : Saint Tropez, Aveyron, Disneyland, Ardèche… Abonnez vous ?

Epinglez moi !
Vous avez aimé cet article ?
Alors n’hésitez pas à le partager ou à l’épingler !
-
Pour suivre l’actualité d’Itinera Magica, aimez notre page Facebook
ou inscrivez-vous à notre newsletter
Merci pour votre soutien et à bientôt !




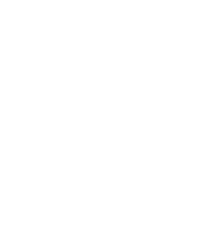






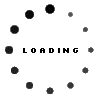











le 13 octobre, 2017 à 19 h 56 min a dit :
J’ai toujours voulu voir cet endroit, ça semble tellement fou !
Merci pour ce petit bout de voyage qui fait assez rêver un vendredi après-midi 😉
Laury
le 13 octobre, 2017 à 20 h 44 min a dit :
Waw ça à l’air incroyable! Un coup de coeur pour le Salvation Mountain. On se croirait dans un film!
le 13 octobre, 2017 à 21 h 58 min a dit :
C’est incroyable cette diversité de paysages ! Le rendu est assez magnétique…
le 13 octobre, 2017 à 22 h 18 min a dit :
Cette description est l’une des plus poignantes et des plus saisissantes que je connaisse. Merci pour la force et l’atmosphère qui se dégagent de ce texte. Il existe aussi un tourisme de la désolation, qui compte des fulgurances au milieu de la noirceur. Itinera Magica nous en offre cette fois une magistrale illustration, dont la puissance évocatrice émeut jusqu’aux tripes.
le 16 octobre, 2017 à 5 h 49 min a dit :
Merci infiniment.
le 13 octobre, 2017 à 22 h 19 min a dit :
Bon. Dans quinze jour on décolle pour une année à sillonner les routes d’Amérique du Sud mais promis… à notre retour on part découvrir les USA xD Votre road trip californien donne envie !
le 16 octobre, 2017 à 5 h 49 min a dit :
L’Amérique du sud me fait rêver ! où ?
le 14 octobre, 2017 à 7 h 58 min a dit :
Dans un de tes précédents articles tu m’a donné envie d’aller voir Joshua Tree, et j’avais planifié de passer par Palm Spring puis Salvation Mountaint (ah ces bloggeuses influences). Mais notre GPS en a décidé autrement, et surtout la tristesse du désert et de ces montagnes défigurées par des foreuses à la recherche de pétrole, nous ont déçu. Je ne sais comment, ni pourquoi vraiment nous avons pris une toute autre route. De Joshua Tree nous n’avons vu que ces arbres, et ses rochers. Point de cactus immenses alors que j’en rêvais, pas de Salvation Mountain colorés. Entre 29palms et Vegas, nous avons traversé le désert de Mojave, et vus denombreuses maisons abandonnées, des routes elles aussi abandonnées . La face cachée de l’ouest des USA, celle qui ne figure pas dans les guides ou sur les cartes postales, encore moins dans nos rêves. Le rêve américain qui vire au cauchemar. Ton article n’est pas triste, tu as su montrer comme à ton habitude avec de jolis mots la face B. Derniérement, dans un groupe sur facebook une dame qui rentrait d’un roadtrip se disait choquée par la pauvreté qu’elle y avait vu. Elle n’était pas du tout préparée à cette vision de ce pays qui fait rêver.
le 16 octobre, 2017 à 5 h 49 min a dit :
Ah je suis tellement désolée de t’avoir entraînée malgré moi au milieu de nulle part dans la fournaise poussiéreuse… Je comprends ton sentiment de face B, de secret honteux. Merci Chacha.
le 14 octobre, 2017 à 8 h 33 min a dit :
J’ai adoré lire cet article ! L’ambiance est loin d’etre joyeuse mais elle est brut, c’est ce qui m’a plu. Parfois on oublie en partant voyager que « tout » n’est pas rose et parfait et tu as reussie a sublimer quelque chose de noir en lui donnant de la couleur à travers tes superbes photos. Tu as eu raison de partager 🙂
le 16 octobre, 2017 à 5 h 33 min a dit :
Merci Ingrid, je suis d’accord avec toi – ce versant sombre du voyage doit parfois aussi être évoqué !
le 14 octobre, 2017 à 9 h 28 min a dit :
J’ai absolument dévoré cet article ! Si puissant, si fort, si émouvant, si révélateur… les mots me manquent tant il m’émeut. C’est fou comme il y a tant de visages du monde qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir, surtout aux USA. Ça me rappelle en quelque sorte notre virée à Washington qui, pareil, nous a amené à voir une autre facette de ce pays où l’on croit que le rêve devient réalité mais qui peut aussi virer au cauchemar. Je trouve ton aventure courageuse. Je ne suis pas sûre d’être capable de mener un roadtrip comme ça toute seule. Chapeau !
le 16 octobre, 2017 à 5 h 33 min a dit :
Merci Clémence, ton commentaire me touche profondément. Pour le road trip en solitaire, tu sais moi je ne suis pas si courageuse, je ne suis pas une backpackeuse qui prend le train seule à travers l’Inde et dort dans un hostel etc, je voyage beaucoup seule mais de façon confortable, avec voiture et hôtel, pour avoir ma bulle de confort et sécurité – c’est seulement à ces conditions que je le sens bien. Merci pour ton passage, vraiment.
le 15 octobre, 2017 à 7 h 46 min a dit :
Triste de voir que la Californie meurt à petit feu. Mon père y a travaillé quelques temps, ne reconnaîtrait plus rien ! J’avoue que je préfère de beaucoup ta 2ème partie sur Joshua Tree, avec ses rochers, ses blocs de granit, ses montagnes escarpées, et ses plaines désertiques parsemées d’arbres incongrus…cela a de quoi suspendre ! Cette flore désertique, composée de yucca resplendit de beauté même de nuit. J’aime beaucoup ton coucher de soleil, un vrai paysage de carte postale ! Bon dimanche à toi. Bises.
le 16 octobre, 2017 à 5 h 31 min a dit :
Merci Martine ! ah moi aussi, je préfère Joshua tree à tout autre lieu évoqué ici ! La Californie m’attriste parfois…
le 15 octobre, 2017 à 14 h 08 min a dit :
Ton billet est une vraie claque ! Pour avoir vécu en Californie et voyagé par là-bas, j’ai ressenti les mêmes émotions. Le malaise de découvrir les ghost towns, la désolation extrême de la Salton Sea, la beauté fragile de Joshua Tree. Ton récit est si immersif que j’avais l’impression d’être à tes côtés – non tu n’étais pas seule dans ton road trip en fait ! 😉
le 16 octobre, 2017 à 5 h 10 min a dit :
Merci beaucoup pour ce commentaire qui me va droit au coeur, je suis très touchée !
le 15 octobre, 2017 à 22 h 56 min a dit :
Comme le disait Morticia : “le noir est une couleur joyeuse”, et il te va très bien. Ton écriture semble plus vibrante quand elle est sombre, moi j’adore ! (et ce n’était peut-être pas le but, mais ta chronique me donne envie de faire un road-trip à la Mad Max vers Salton Sea… le road-trip apocalyptique, nouveau créneau du voyageur “hors des sentiers battus” ?)
le 16 octobre, 2017 à 5 h 10 min a dit :
Ahaha j’adore ton commentaire – je pense qu’il y a effectivement une mode du road trip apocalyptique, regarde un peu les autres blogs qui parlent de Salton Sea, tu comprendras ce que je veux dire – super cool, les camés et la désolation 😉 Merci Audrey. J’ai plusieurs styles d’écriture et c’est parfois difficile de trouver le bon équilibre entre “écrire pour soi” et “écrire pour les autres”. Et Morticia… un jour, il faudra que je raconte comment, suite à un malentendu macabre, mes étudiants m’ont appelée Morticia pendant toute une année universitaire !
le 16 octobre, 2017 à 9 h 30 min a dit :
J’ai adoré ton article si bien écrit et quelques passages sont vraiment émouvants ! ^^
Je croyais avoir déjà vu tes photos de ce voyage, mais le lire aujourd’hui avec mon souvenir de mon passage près du désert de Mojave si frais en tête, ça me parle beaucoup.
le 16 octobre, 2017 à 13 h 34 min a dit :
Et bien j’adore cet article, vraiment ! Ton texte est parfait, j’avais l’impression d’être avec toi là-bas.
En plus il arrive au bon moment vu que nous-mêmes retournons en Californie très bientôt. On a prévu d’aller à Joshua Tree et de passer une nuit au village. Du coup on ira peut-être voir le bar dont tu parles… 🙂 J’aime les endroits alternatifs, je m’y sens bien. J’aime tout ce qui est punk, rockabilly, les cheveux fluos, les robes de pin-up… (et en Californie, tout ça ne manque pas <3 )
D'ailleurs j'adore tes robes !! <3 En fait tu m'as donné envie d'amener une de mes robes "pin-up" là-bas, on verra s'il y a la place dans les bagages x)
Et comme d'habitude, je me répète, mais c'est vrai, tes photos sont magnifiques !
le 16 octobre, 2017 à 14 h 31 min a dit :
Merci Mandy, ça me fait tellement plaisir ! vous avez bien raison d’aller au village de Joshua Tree, c’est un lieu super attachant. Le resto/bar Pappy and Harriet’s, je te le recommande sans hésiter, c’était super bon, abordable et il y avait une ambiance de folie (pourtant, c’était un jour de semaine). Ah ah merci pour les robes ! je suis spécialiste du combo robe + baskets, et après pour la photo j’enlève les chaussures et je me mets pieds nus 😉
Merci pour mes photos, ça me fait vraiment plaisir !
le 16 octobre, 2017 à 13 h 36 min a dit :
J’ai oublié de te poser une question, combien de temps as-tu passé à Joshua Tree (le parc) ? Histoire de me donner une idée si j’ai prévu assez de temps ou pas…
le 16 octobre, 2017 à 14 h 34 min a dit :
J’y ai passé une journée complète (j’avais dormi la veille à Indio à même pas une demi heure de route, du coup j’ai attaqué Joshua Tree vers 8h45 du matin), une nuit au Joshua Tree Inn avec sortie la nuit pour voir les étoiles, et encore une demi journée avant de repartir vers le nord (pour reprendre la route 66) vers midi. Donc 1 jour et demi en tout. Je n’ai pas été frustrée, j’ai eu la sensation d’avoir assez de temps, un coucher et un lever de soleil, le temps d’explorer, etc. MAIS je n’ai pas fait de grosse rando, je n’ai fait que des boucles d’1h/1h et demi. Il y a des randos de 3, 5 ou 6h pour ceux qui le désirent, pour aller voir une mine abandonnée par exemple. C’était tentant, mais pas seule – je n’ai pas un super sens de l’orientation, et j’ai eu peur de me perdre, de paniquer parce que j’étais seule, etc. Si vous comptez faire de grosses randos, peut-être prévoir plus de temps !
le 16 octobre, 2017 à 13 h 47 min a dit :
Je crois que c’est là mon billet préféré! Peut-être parce qu’il est plus sombre justement et qu’on apprend ainsi à mieux te connaître. Les récits que tu fais de ces paysages désolés sont absolument captivants et merveilleux. Tu arrives à rendre belle toute chose <3 Mais étais-tu vraiment seule lors de ce voyage (rapport aux photos de toi 🙂
le 16 octobre, 2017 à 14 h 37 min a dit :
Merci beaucoup pour ton retour, le fait que ce billet vous plaise tant me surprend et me fait plaisir, je pense qu’il est moins “grand public” mais qu’il plaît à mes lecteurs les plus fidèles, et ça me fait très plaisir, MERCI pour votre soutien <3 Ton commentaire adorable me touche vraiment, je me prends pour Baudelaire là, qui transforme la boue en or, ok je me calme. Oui, j'étais vraiment toute seule, je n'ai parlé à personne pendant 15 jours ou presque, à part justement le soir à Joshua Tree Inn, c'était drôle ! Pour les photos, fastoche : trépied + télécommande 😉 on est une blogueuse pouf ou on ne l'est pas, hein.
le 17 octobre, 2017 à 9 h 41 min a dit :
Merci beaucoup pour toutes ces informations !! Je te dirais si on teste le resto à Joshua Tree 😉
le 18 octobre, 2017 à 9 h 33 min a dit :
Pfiou quel récit, tu m’as captivé. C’est un très beau texte, très direct et assez émotionnel. Quand on a une idée de ce à quoi peut ressembler la Californie côtière, on découvre en fait l’envers du décor ici. J’avais entendu parler de ce coin, du côté de Salton Sea et Niland, mais je n’avais pas autant de détails puisque je n’avais pas pris le temps d’y aller quand je vivais à Los Angeles. Ça semble être assez impressionnant et désolant…
Et Joshua Tree en l’occurrence semble à l’opposé, j’ai bien aimé les détails géologique que tu as joint à ton texte, c’était très intéressant.
Tu avais besoin de ce road-trip en solitaire, ça t’avais fait du bien au final ? Surtout en rencontrant des lieux aussi opposés l’un de l’autre et en vivant autant d’émotions différentes ?
le 18 octobre, 2017 à 9 h 49 min a dit :
Sympa le Joshua Tree Inn!! 😀
Mais je reviens sur la première partie de ton récit, qui m’a tellement obnubilée que j’ai eu du mal à me concentrer sur le reste de ma lecture.
En effet, ces texte est beaucoup plus sombre que ce que l’on a l’habitude de lire sur ton blog, mais en même temps on reconnaît la douceur de ton écriture, même dans ce pessimisme, et encore une fois j’ai adoré te lire.
Je comprends la vague de désespoir qui semblait te submerger face à tant de désolation, jusqu’à ce que tu aperçoives Salvation Mountain. Mais clairement le jeu en valait la chandelle, quel endroit incroyable!
le 18 octobre, 2017 à 12 h 10 min a dit :
Derrière la magie d’un lieu se cache parfois l’obscurité… La nature et l’humanité toute entière sont ainsi faits d’une étrange complexité : derrière un regard lumineux se cache parfois tant de tristesse… Le contraste entre ce monument magique et tout coloré tout droit sorti d’Alice aux pays des merveilles, où on se dit que le créateur a dû manger beaucoup de champis pour transformer le monde en couleurs (j’adore tes photos de salvations mountains), et la misère et la désolation que tu as rencontré à quelques kilomètres… Cela permet aussi de prendre parfois du recul par rapport à certaines choses, remettre les choses dans leur contexte et réfléchir sur la façon dont nous menons notre vie…
Mais je me dis que ça a dû être dur pour toi d’encaisser ça, en partant toute seule à l’aventure (déjà bravo, je trouve ça courageux de partir seule, je passerai peut-être un jour le cap, pour l’instant je ne m’en sens pas capable), et d’avoir personne pour partager ces moments là qui sont lourds à porter !
Euh, sinon, Joshua Tree, ça a l’air fabuleux, et puis ton récit aussi noir soit-il sur une partie est toujours aussi vivant et agréable à lire… Mais comment tu fais 😀 😀 😀 ???
le 18 octobre, 2017 à 17 h 50 min a dit :
Tu nous avais beaucoup parlé de ce voyage, de ce que tu attendais, de l’excitation sous jacente, etc. Tu m’avais parlé de ta déception, des petits événements aussi qui avait fait que ton voyage ne s’était pas passé comme tu l’avais espéré.
Quand j’ai lu “c’est le pays de Steinbeck” mon coeur s’est accéléré, et j’ai fait le lien : mais oui, bien sûr… Je suis en train de lire Les Raisins de la Colère, avec cette terre aride, maudite même. Je comprends mieux.
Tu sais que ma maman m’a offert un livres listant les lieux maudits, et que je raffole de ce genre d’histoire, comme salton sea. Je me suis régalée avec ton article, cette terre déserte, meurtrière, qu’on ne soupçonne pas… J’ai notamment adoré ces phrases ” je les accueille avec la joie de l’enfant qui découvre un Kinder surprise dans une décharge.” et “Moi je vois des gens défoncés au regard vide et à l’avenir qui se reflète dans le Salton Sea.”
Pour les photos :
– Salvation Mountain. : je l’adore, traitée comme ça elle est parfaite (sans l’ombre surtout) ! Avec ta robe à fleurs, on dirait presque un tournage de film 😉
– la photo de la route : <3 superbe, je l'adore, elle est absolument parfaite !!
– Les photos de Salvation Mountain, de manière générale : j'adore, surtout les dernière au coucher du soleil. C'est complètement fou, ça n'a rien à faire là, complètement délirant, c'est génial 😀 Et avec ton récit en plus, on s'y croirait ! (J'admire ta politesse aussi 😉 )
– Les photos de Joshua Tree avec le ciel rosé sont sublimes elles aussi !
J'ai A-DO-RE cet article, peut-être même encore plus la première partie plus sombre, plus vrai, plus… Steinbeck ? J'en sais rien, c'est peut-être mon côté glauque qui veut ça, mais j'ai vraiment été plongée dans ton récit !
le 18 octobre, 2017 à 19 h 43 min a dit :
[…] parfois, cela dérape. Je racontais dans mon dernier article sur la Californie comment tout le monde m’avait proposé du sexe, tout le temps. Je l’ai raconté avec humour. […]
le 19 octobre, 2017 à 10 h 11 min a dit :
Merci pour ce superbe article. Installée derrière mon bureau, tu m’a littéralement fait voyagé ! Quel article ! Comme toi, j’ai traversé (un peu) le parc de Joshua Tree mais je ne connaissais pas le coin de Salon Sea, Salvation mountain.. merci pour cette histoire très intéressante et comme tu le dis si bien “la terre, ici, peut dévorer les hommes.”!
Sophie
le 19 octobre, 2017 à 11 h 57 min a dit :
Ton texte m’a pris aux tripes. C’est beau et tellement triste cette apocalypse initiée par l’homme et cette épouvante programmée. Les laissés pour compte transparents que personne ne souhaite voir. J’aime cette partie sombre et brute, les mots sont là comme des poémes pour placer le bon mot, la bonne sensibilité juste là où il faut.
La seconde partie est très belle aussi, on souhaite partir aux état unis on ne sait pas encore quand, ces grands espaces nous tourne la tête 🙂
le 20 octobre, 2017 à 8 h 57 min a dit :
Quel récit incroyable. Tu nous fais vivre en direct tes émotions contradictoires, celles que souvent on laissent de côté quand on parle voyage . Pourtant, dans tous les pays, certaines choses nous désolent . J’imagine que les Usa sont certainement le pays le plus étrange de ce point de vue !
le 23 octobre, 2017 à 12 h 50 min a dit :
Hello Alexandra,
Merci pour cet article hors des sentiers battus, tant géographiquement que textuellement !
Je dis: “encore” !
le 23 octobre, 2017 à 17 h 55 min a dit :
alors la je suis sans voix de cet article! D’ailleurs je commente mais je ne sais finalement pas trop quoi commenter… ! Déjà merci pour cet article, qui ouvre nos esprit. tu nous fait découvrir un autre monde que l’on pense qui existe que dans les films les plus trash. Tu m’as appris beaucoup aujourd’hui avec cette lecture. Et comme d’habitude, je te lis du début à la fin.
le 23 octobre, 2017 à 18 h 00 min a dit :
superbe récit
clairement une face de la Californie qu on ne voit jamais
un autre monde
de la Californie découverte en 2015 je ne connais que San Diego et San Francisco
avec 1 journée à LA
le 25 octobre, 2017 à 22 h 49 min a dit :
J’ai pris beaucoup de retard à lire tous tes articles ! Waouh, tu as beaucoup bougé ces derniers mois 🙂 J’adore particulièrement tes récits des Etats-Unis. Ces photos de Californie vendent du rêve, et des couleurs et du soleil ! J’aime beaucoup!
Les USA ont été mon premier grand voyage… mais j’aimerais tellement y retourner !
le 19 janvier, 2018 à 20 h 39 min a dit :
Wouaw. Tes mots sont puissants. Honnêtement je ne trouve pas d’autre adjectif. Ton article a été un plaisir du début à la fin, qui me prouve encore une fois que tu es une blogueuse comme on en voit peu. Tu as peut-être détesté une partie de ce que tu as vu dans ton voyage, mais au final tu en as ressorti un article magnifique, prenant, et rempli d’informations. Au début de l’article tu es presque désolée de le publier, mais ne le sois pas ! C’est normal de ne pas aimer tout ce qu’on voit, et quand on le raconte comme toi tu le fais, ce serait une erreur de ne pas le publier. Bisous !
le 25 janvier, 2018 à 22 h 31 min a dit :
Merci Léonor, ça me touche infiniment.
le 29 mars, 2019 à 14 h 14 min a dit :
J’ai hâte de découvrir ton article sur l’Ardèche, j’y suis née et y ai passé mes 19 premières années (ensuite j’ai pris le large!) Ton article Californien n’est certes pas très joyeux – ça change de tes autres articles ! Nous n’avons pas fait cette partie de la Californie (nous sommes passés de LA au Sequoia National Park puis à la Death Valley) On a adoré chaque partie de notre roadtrip et j’avoue que le Joshua Tree est toujours sur ma do to list (car je reviendrai en Californie, c’est certain – plus tard, un jour). 🙂
le 2 janvier, 2020 à 12 h 59 min a dit :
Bravo pour ce point de vue rare. La fascination de l’empire américain est encore tellement forte, plus forte que la réalité désespérante et désespérée d’une fraction énorme de la population. Oui, tout est vrai, tout est exactement comme décrit avec cette plume formidable. L’envers d’un décor de cauchemar, la drogue et l’exclusion, d’une société délitée où chacun vit dans son ghetto : les Riches , les homos, les golfeurs à Palm Springs, les fachos, les paumés, les illuminés partout ailleurs, et entre les deux, les esclaves qui viennent tondre et tailler les jardins manucurés les immigrants mexicains, salvadoriens ou colombiens… une terre triste , une société triste qui ne fascine la planète que grâce au maquillage dont le cinéma l’a paré. Oui cette misère béante éclate à la face de ce paysage vide, magnifiquement vide, sec et lunaire. Le paysage est sublime, notamment lorsque le soleil délire en de somptueux crépuscules. Oui c’est une terre de morts vivants. Jamais je n’ai ressenti cette même impression de me retrouver dans le clip « Thriller » qu’à San Fransisco, un soir en sortant d’un supermarché vers 20h. A chaque feu, sur les trottoirs des mendiants , de tous âges , toutes origines , le regard creux et l’air hagard balançant mollement des gobelets en cartons pour récolter des dimes et des cents, la mendicité s’exposant. Et cette scène dantesque ne se déroulait pas dans le fameux quartier du centre ville réputé pour ses mendiants … non, non cette grande avenue abritait à 100m un orgueilleux garage Rolls-Royce. Vertige. Écœurement. Duperie. Voilà bien les sentiments que j’ai aussi ramené de Californie. Et du coup, j’ai réalisé l’ampleur de la propagande quasi soviétique dont nous sommes tous intoxiqués. Depuis, Trump dirige son empire et de pire en pire. Et les yeux commencent à s’ouvrir. Merci de votre témoignage authentique. Et bravo pour ce blog superbe, sensible et intelligent.
Un alsaco qui vous encourage à continuer !
le 2 janvier, 2020 à 16 h 08 min a dit :
Merci de tout coeur pour ce commentaire qui me touche énormément.
le 3 janvier, 2022 à 21 h 09 min a dit :
WOW ! Voilà ce qui me vient là, tout de suite, après avoir lu ton texte ! Quelle sincérité et quelle poésie pour décrire ce que tu as vécu ! Et bizarrement, comme pas mal de tes lecteurs, je n’ai qu’une envie, prendre la route et m’y rendre pour le voir de mes propres yeux !
Merci pour ce beau récit et ces magnifiques photos 🙂
Elodie
le 3 janvier, 2022 à 21 h 16 min a dit :
Merci chère Elodie <3