#Moiaussi : pour que la honte change de camp-
#Moiaussi, ou #metoo : c’est le hashtag qui fédère en ce moment les femmes dont la parole se libère enfin. Des femmes de tous âges, de toutes origines et de tous milieux sociaux témoignent avoir été victimes d’agressions sexuelles ou de harcèlement, de la part d’hommes de leur entourage ou d’inconnus. Chaque témoignage est glaçant, mais ce qui est pire que tout, c’est leur nombre, leur déferlement ininterrompu. Toutes les femmes, ou presque, ont connu cela. Le bâillon est tombé, et les récits pleuvent.
Et j’ai l’espoir que ce soit le grand soir de la cause féministe, le séisme qui ébranlera enfin le vieux monde misogyne.
Ceci n’est pas une confession
Cela fait plusieurs jours que j’hésite. Mais moi aussi, #moiaussi, j’ai besoin de vous raconter.
Pas sur Twitter, pas en 140 caractères. Je vous raconterai ici, dans cet espace qui m’appartient, où j’ai le temps de vous livrer à mon rythme ce récit et cette réflexion.
J’ai failli écrire « cette confession ». Mais non : la confession, c’est l’aveu du coupable. Et moi, je ne suis coupable de rien.
La première agression, ou le « malentendu »
J’ai treize ans. En vacances, je suis sortie avec un garçon bien sous tous rapports, gentil et intelligent. Sexuellement, nous ne sommes pas allés plus loin que ce qu’on appelait à mon époque une « pelle ». Ce stade-là me convient très bien.
Une fois rentrée chez moi à la fin du séjour, j’insiste pour aller lui rendre visite. Ce n’est pas le grand amour, mais je l’aime bien, et la ville dans laquelle il habite me tente beaucoup. Il m’a promis qu’on ferait du tourisme, qu’on irait à un concert. Ma mère hésite, puis appelle sa mère à lui, une femme très bien. « Aucun problème, je serai à la maison, elle peut venir. »
La journée se passe à merveille. Et puis le soir, nous nous retrouvons dans sa chambre. Sa mère est sortie. Nous sommes seuls. Que dire, si ce n’est que je ne contrôle plus rien ? Que les choses vont plus loin que ce que je voulais ? Je dis non, je lui dis « je préfèrerais garder mes vêtements », il réinsiste. Je me tortille, je me détourne, je me lève, je dis « ça te dirait qu’on aille regarder un film dans le salon ? », je passe du lit au canapé. Il m’y suit. Il n’y a aucune violence, juste ma passivité, ma froideur pétrifiée qu’il ne comprend pas. Je n’ai pas hurlé « lâche-moi », j’ai juste attendu. Je crois qu’il ne sait même pas que je n’étais pas d’accord. Je l’ai revu par hasard des années plus tard. J’étais glacée, lui très chaleureux. Charmant.
La deuxième agression, ou l’enfer du métro
J’ai dix-neuf ans, je suis à la fac à Paris. C’est le mois de septembre et l’été dure, il fait chaud, je suis en jean et chemisier blanc, un joli chemisier avec un col en dentelle, façon héroïne romantique. Je n’ai pas de veste. Je rentre de cours dans le métro bondé, quelqu’un me bouscule involontairement. Un mouvement brusque pour me rattraper, et mon chemisier craque. Deux boutons, pile sur la poitrine. Je porte un soutien-gorge, mais j’ai toujours eu beaucoup de poitrine, et ma mésaventure vestimentaire ne peut échapper à personne, tout le monde voit que je suis à moitié dépoitraillée. Je suis cramoisie. Je n’ai rien pour me couvrir.
Et ça commence. Un homme de cinquante ans, en tenue de cadre, passe sa langue sur ses lèvres en me regardant lubriquement. J’essaie de croiser mes bras, de me tourner vers le bord du wagon. Un homme d’une trentaine d’années vient se coller contre moi. Au début, je crois qu’il veut me cacher aux regards. Puis je sens quelque chose de tout dur contre ma cuisse. Son sexe en érection. Je suis paralysée, je ne bouge pas. J’attends que les stations passent, j’ai les larmes aux yeux. Je ne réagis pas, je ne repousse pas ce salaud, sans doute parce qu’au fond de moi je me dis que c’est ma faute. Parce que quand ton chemisier craque, c’est bien fait pour toi, tu mérites qu’on te colle une bite contre la cuisse. Evidemment.
La troisième agression, ou comment j’ai été agressée par un ancien ministre
Ce n’est pas la « pire », mais celle qui m’a intellectuellement le plus ébranlée. Parce que les deux premières fois, je me disais que c’était peut-être ma faute. Je n’avais pas su dire non. Je n’avais qu’à prendre une veste.
Mais cette fois-là, j’ai compris que ça pouvait arriver à n’importe quelle femme, dans n’importe quelle circonstance, que personne n’était à l’abri.
Il faut que je vous détaille le contexte, pour que vous compreniez à quel point c’était inouï, à quel point cela révèle le sentiment d’impunité des prédateurs, et tout particulièrement, des prédateurs puissants.
J’avais vingt-ans. A cette époque, mon père était ministre. Il était très exposé médiatiquement, et je souffrais beaucoup de cette attention extrême, de ce climat polémique qui rôdait tout le temps autour de lui, de ma famille, et j’aurais mille fois préféré l’anonymat. Mais le seul privilège de ministre qui me consolait, le seul dont lequel j’étais heureuse de bénéficier, c’était l’opéra. Le merveilleux opéra de Paris invitait régulièrement les ministres à assister aux représentations, et mon père, qui connaît mon amour pour l’art lyrique, me faisait souvent bénéficier de la deuxième invitation. L’y accompagner était une joie immense. Ce soir-là, nous allions voir un Wagner à l’opéra Bastille (était-ce Parsifal ? était-ce le Ring ?), et j’étais aux anges. Mais mon père a eu une urgence à gérer, et n’a pu me rejoindre qu’à l’entracte. Du coup, les sièges étaient rebattus, et quelqu’un s’est assis à ma droite, là où mon père aurait dû être.
Je ne sais pas si vous connaissez l’opéra Bastille. Dans cette immense et magnifique salle, une rangée est considérée comme la « rangée VIP ». C’est la catégorie Optima, la première rangée du premier balcon, en plein milieu de la salle (et non pas devant la scène), avec personne devant vous sur plusieurs mètres. C’est la rangée la plus exposée, où on voit aussi bien qu’on est vu. Les ministres, les hautes personnalités, les stars, sont toujours placés là, et c’était un immense bonheur pour moi de pouvoir en bénéficier. J’insiste là-dessus pour expliquer que ce ne sont pas des places discrètes, où on serait caché dans l’ombre. Ce sont des places où tout le monde sait qui vous êtes et voit ce que vous faites.
Un vieux monsieur à l’air éminemment respectable s’assoit donc à ma droite. Son épouse est à sa droite à lui. J’insiste. Son épouse est là. La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu’il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J’enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d’indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C’est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra Bastille. Wagner sur scène, le vieux pervers contre la gamine en pantomime dans la salle.
A l’entracte, mon père arrive. Je le vois soucieux, je ne veux pas le stresser davantage. J’ai peur qu’il aille casser la gueule du type en plein opéra et qu’on ne puisse pas finir la représentation. C’est bête, mais je me tais aussi par respect pour sa femme assise à côté de lui – je ne veux pas l’exposer à cette humiliation. Je ne dis rien à mon père. Mais je change de place, et je demande à son officier de sécurité : « Pouvez-vous me dire qui est cet homme ? » Cinq minutes plus tard, il me donne la réponse, je cherche sur Google, je vérifie. C’est bien lui. Et je suis estomaquée.
C’est un ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de l’Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens. Une statue vivante. La représentation recommence, je suis tranquille, mais je n’arrive pas à me concentrer sur la mort des Dieux et les vocalises de la cantatrice.
Je repasse en boucle ce qui vient de se passer. Je suis fille d’un ministre en exercice, dans la rangée VIP d’un des lieux les plus huppés de la capitale, en pleine lumière. L’homme assis à côté de moi a occupé les plus hautes fonctions de l’Etat, est unanimement respecté, et accompagné de son épouse. Et il m’a agressée pendant tout un premier acte, malgré ma résistance vigoureuse.
Je mesure soudain ce que cela signifie, et j’ai le vertige. Si cela m’arrive ici, maintenant, à moi, par lui, c’est que cela peut arriver à n’importe quelle femme, partout. Que personne n’est à l’abri.
Dans la voiture en rentrant, je raconte à mon père et à son officier de sécurité. Passé le moment de fureur, nous décidons de ne rien faire. Je ne supporte plus sa surexposition médiatique, qui m’affecte aussi par ricochet. Je sais que si je « balance mon porc », pour reprendre l’autre hashtag en vigueur actuellement, tous les regards seront braqués sur moi. Je ne dis rien.
Mais cela fait huit ans que j’ai envie de lui mettre une droite, et que parfois la nuit, je rêve que je l’ai fait, en pleine représentation, devant sa femme, devant tout le monde. En être réduite à rêver de tabasser un vieux, si ça ne l’est pas de l’impuissance.
Vous allez peut-être me dire « donne son nom ». Un reste de peur me retient, mais je crois avoir donné beaucoup d’indices. Et s’il se reconnaît et qu’il lui prend l’envie saugrenue de m’attaquer en diffamation, qu’il sache que mon père et son officier de sécurité d’alors pourront témoigner contre lui. Qu’il sache que je le méprise profondément, et que je plains sa femme.
La quatrième, la cinquième et la centième fois : une femme qui voyage
Je suis une voyageuse, une journaliste, une blogueuse voyage professionnelle. Je voyage souvent seule, loin de chez moi. C’est ma passion et mon métier. La plupart du temps, les gens sont bienveillants et chaleureux. Je fais de belles rencontres, sans arrière-pensée, avec des femmes et des hommes amicaux.
Mais parfois, cela dérape. Je racontais dans mon dernier article sur la Californie comment tout le monde m’avait proposé du sexe, tout le temps. Je l’ai raconté avec humour. C’est devenu mon mode de défense. La politesse et l’humour. Je souris, je dis « non merci » comme si on m’avait proposé une tasse de thé, je fais une blague, parce que je suis petite, une femme, qui n’a jamais fait d’art martial et qui préfère la stratégie d’évitement au conflit frontal. J’ai peur de me faire casser la gueule, violer, tuer. Donc je plaisante. Je suis mignonne, inoffensive. A un homme qui me demande de but en blanc, dans les rues de Nancy, si je veux un « bukkake » (terme japonais qui signifie l’éjaculation simultanée de plusieurs hommes sur une femme placée au centre de leur cercle), je réponds « non merci, je viens déjà de manger des sushis ». Il rigole, il me laisse tranquille. Et moi, je normalise ça. Je ne fais plus attention, je m’habitue.
Aujourd’hui, en voyant déferler les #moiaussi, je me dis que je ne veux plus accepter. Je ne veux plus normaliser. A chaque agression, j’ai été passive, je n’ai pas voulu déranger, j’ai pris la honte sur moi au lieu de la renvoyer sur celui qui méritait de la ressentir. Mais je ne suis pas coupable. Nous ne sommes pas coupables, et rien ne justifie le harcèlement.
Peu à peu, le monde commence à comprendre que, si tous les hommes ne sont évidemment pas des agresseurs, toutes les femmes ou presque ont un jour été agressées par un homme. Que c’est grave, et qu’il faut réagir.
Je ne me suis pas mise à haïr les hommes, j’en connais des tas de bien. Je ne crains pas les inconnus, j’ai fait des dizaines de rencontres paisibles et chaleureuses. J’aime les gens. Je n’ai pas une nature méfiante. Mais j’aspire à un monde amical et sain, où la confiance et l’amitié sont permises par le respect mutuel. Où personne ne vous touche, ne commente votre corps, ne vous scrute, sans votre consentement. Et je crois que cette semaine, nous avons fait un pas dans la bonne direction. Continuons le combat.
Mise à jour en novembre 2022 : Suite à la parution de cet article, Pierre Joxe m’a attaquée en diffamation en janvier 2018. Cinq ans de procès ont suivi. J’ai perdu en première instance. J’ai fait appel. J’ai gagné en appel. Pierre Joxe en a appelé à la Cour de Cassation, qui a confirmé la décision de la cour d’appel en ma faveur. Pierre Joxe ayant renoncé à contester devant la CEDH la décision de la Cour de Cassation, il a définitivement perdu le procès en diffamation qu’il m’avait intenté.
Vous avez aimé cet article ?
Alors n’hésitez pas à le partager ou à l’épingler !
-
Pour suivre l’actualité d’Itinera Magica, aimez notre page Facebook
ou inscrivez-vous à notre newsletter
Merci pour votre soutien et à bientôt !




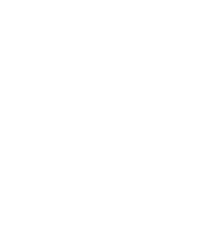


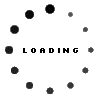















le 18 octobre, 2017 à 20 h 23 min a dit :
Je restes sidérée par le nombre d’amie qui osent dire tout haut ce qui leur est arrivé. Les hommes sont également touchés, plus que ce qu’on imagine, et les langues se délient petit à petit.
Personnellement, j’ai eu droit à une tentative de baiser par un vieux aux milles chicots à la descente du bus en Angleterre. J’avais 16 ans.
On m’a aussi demandé si j’avais pas 5 minutes pour “sucer la bite” d’un gars alors que j’avais réussit l’exploit de me motiver à faire du vélo, dans Gap, petite ville française.
Cet été un homme m’a proposé de m’aider à finir de manger ma glace. Comme toi, j’ai refusé avec le sourire sur le ton de l’humour. Il ne s’est pas arrêté et l’a pris en rigolant.
C’est épuisant de toujours avoir à se méfier, à prendre plus de précautions que les hommes en voyage et de toujours devoir trouver des parades pour ne pas se trouver dans ces situations. On devrait avoir le droit/capacité de leur rendre la pareille.
le 18 octobre, 2017 à 20 h 24 min a dit :
Je suis désolée, Martine. Personne ne devrait subir ça. Plein de pensées.
le 18 octobre, 2017 à 20 h 39 min a dit :
Putain ton texte est puissant et révoltant. Je partage et compatis. Et j’ajoute que, #moiaussi
le 18 octobre, 2017 à 20 h 40 min a dit :
Je suis désolée, Lucie 🙁 De tout coeur avec toi. Et merci.
le 18 octobre, 2017 à 21 h 51 min a dit :
Wow, je suis sans voix. Quel courage cet article! Merci, c’est important.
le 18 octobre, 2017 à 22 h 52 min a dit :
Merci beaucoup, Margaux. Oui, c’est important ce qui se passe en ce moment, ce mouvement de libération de la parole, de révolte.
le 19 octobre, 2017 à 7 h 53 min a dit :
Je venais lire ton article sur la Californie et je tombe sur ça. J’ai les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée pour toi et pour toutes les femmes qui ont subit de telles choses. Et puis je réfléchi un peu plus et #moiaussi … peut être pas aussi « pire » mais finalement je me dis qu’il n’y a pas d’échelle pour mesurer de tels actes… 🙁
le 19 octobre, 2017 à 8 h 59 min a dit :
Ton histoire, comme celles des femmes qui témoignent est poignante, révoltante, écœurante et tout à fait caractéristique d’une société patriarcale où les hommes pensent détenir le pouvoir sur le corps des femmes, celui-là même qui est trop souvent placé encore comme enjeu financier, comme monnaie d’échange, comme façon de survivre et de gagner sa vie…
Je suis heureuse que les langues se délient enfin et atterrée par les témoignages très nombreux.
Je suis atterrée mais non étonnée. Féministe depuis longtemps, je sais ce que beaucoup ignore ou font semblant d’ignorer et je sais les viols, les agressions, le harcèlement, la grivoiserie, les blagues lourdes, les histoires de blondes, les peurs dans les parkings le soir, les filles que l’on emmerde, les mains sur les fesses, les bites contre les cuisses … Le projet crocodile dénonçait tout ceci fort bien déjà il y a quelques années.
J’ose espérer que c’est un premier pas vers un changement durable, une véritable prise de conscience et surtout que la honte va enfin changer de camp.
Je suis de tout cœur avec toutes les femmes et tous les hommes victimes d’actes d’incivilité, d’agressions, de viols et pour qu’enfin on puisse vivre dans le respect du consentement.
Quant à ton expérience, tu sais, tout comme moi, la force des mots et celle de l’écriture. Pour toi et pour toutes celles et ceux qui te liront.
Bien à toi
le 19 octobre, 2017 à 9 h 09 min a dit :
Bien sûr que #MoiAussi comme nous toutes. C’est terrible de se dire nous avons toutes vécu ça, et qu’on arrive à en parler que maintenant. J’ai hésité à écrire quelque chose chez moi, mais je n’ai pas trop le coeur, alors je poste ici, je me dis que si tu as écrit, c’est (aussi) pour qu’on parle. Des anecdotes j’en ai par centaines. Il y en a quelques unes de marquantes. La première, c’était vers 16 ou 17 ans, un ami d’ami s’était pris d’amour pour moi, et dès qu’il me croisait dans la rue il me demandait de lui sourire, de lui parler, de l’épouser !! Je me souviens en avoir parlé avec des amis que ce cirque était quand même pénible, que j’en venais à appréhender le moment de sortir de chez moi, ce à quoi on m’a répondu : “ça va c’est pas méchant!!”. Non c’est vrai c’était pas méchant mais de quel droit je ne pourrais pas avoir la paix quand je marche dans la rue !!! Je passe sur les sifflements, les “suces moi”, “j’ai envie de baiser” quotidien pour une jeune fille de 20 ans. Mais je m’arrête à ce jour de printemps, je devais avoir 20 ou 21 ans, où en pleine journée, dans la rue, un homme ivre s’est jeté sur moi et m’a carrément agrippé entre les jambes. Il était mort saoul j’ai pu le pousser et le faire tomber, et je me suis échappée en larmes. Ma mère n’a pas décoléré pendant un bon moment. Ma grand-mère a beaucoup rigolé : pour elle il n’y avait rien de grave à ce qu’un homme ait ce genre de geste. Bien sûr les années passent, les mentalités évoluent, mais je sais que nous partons très très loin, nous partons d’un temps où même pour les femmes l’agression sexuelle était quelque chose de normal. Aujourd’hui, il m’arrive encore d’être emmerdée, il m’arrive encore d’être emmerdée alors que je me promène avec mes filles, ce qui bien sûr fait naître un sentiment d’insécurité terrible pour la maman que je suis. On entend beaucoup en ce moment qu’on protège trop nos enfants … ce à quoi j’ai bien envie de répondre : la faute à qui ???
le 19 octobre, 2017 à 9 h 52 min a dit :
Au début, je me suis dis que nous stigmatisions les hommes, mais avec tout ce déferlement, je commence à comprendre que l’on met en lumières des comportements que certains hommes pensent “normal”. Ça m’a fait remonter de mauvais souvenirs, et je rêve désormais que les petits garçons s’éduquent dans le respect de l’autre, qu’il soit homme, ou qu’il soit femme, et même qu’il soit animal ou végétal. J’ai subi des choses que j’ai minimisé mais à lire les témoignages, je me rends compte que c’est finalement assez grave, et je comprends à quel point j’ai été minée et qu’il m’a fallu un amour fort pour aimer de nouveau les hommes, avec bienveillance.
Merci pour ton témoignage.
le 19 octobre, 2017 à 10 h 11 min a dit :
J’ai juste envie de te faire un gros câlin en lisant ton article!
Il y a bien plus de porcs qu’on ne le pense…
le 19 octobre, 2017 à 10 h 14 min a dit :
Merci pour ton témoignage dans lequel je ne peux que me reconnaître car #moiaussi.
J’étais en stage dans une grande et belle entreprise et mon tuteur m’a proposé des choses indécentes.
Enfin, on peut en parler !
le 19 octobre, 2017 à 11 h 22 min a dit :
Tous ces témoignages me glassent, tout se fait en toute impunité, c’est révoltant, et c’est encore plus choquant de les voir toujours plus se multiplier comme si c’était la normalité.
Je repense à une situation, qui fait probablement parti de mes #moiaussi (il y a a tellement, dont certains que je suis même pas capable de raconter encore), mais un autre angle. J’ai été harcelée, mais du harcelement violent, constant, épuisant, celui qui fait que tu as peur pour toi et que tu as peur de rentrer chez toi. Pendant 6 ans. J’ai posé une main courante, on m’a poussé à porter plainte. Tu sais qu’au commissariat, ils n’ont pas voulu accepter mon dépot de plainte au départ ? j’ai du me battre, j’ai cu que j’allais défoncer ce connard de flic (fovcrément, un mec). Et je trouve ça révoltant, sidérant; Je ne comprends pas, et il y a urgence à prendre les femmes au sérieux, parce que ça suffit.
le 19 octobre, 2017 à 11 h 30 min a dit :
Franchement bravo d’avoir pris le temps d’écrire ce texte. Plus j’en vois, plus ça m’horrifie de voir à quel point ça nous est toutes arrivé au moins une fois. J’espère que cette parole libérée ne restera pas sans conséquences surtout. Et qu’on arrêtera de se sentir coupable alors que ce sont eux les coupable, les malades.
le 19 octobre, 2017 à 11 h 30 min a dit :
Il y a tellement de témoignages hallucinants qui défilent, des témoignages lourds, comme les tiens, qu’il est difficile de placer un #metoo au milieu. Car cela a pris une tel ampleur que les phrases déplacées finalement semblent être bien peu… alors que oui, mais non.
Ce que je trouve incroyable c’est le culot de certains hommes.
Ainsi mon dernier #moiaussi c’était il y a deux mois. J’étais dans un train avec une copine, son fils et ma fille. Nous avions tous des vélo (son le petit garçon qui est sur le siège avec sa maman, déjà installé au moment de descendre du train). Devant la porte, un homme nous regarde bizarrement, je ne suis pas à l’aise, mais on arrive. Et là, je ne sais pourquoi au moment de descendre ma fille s’embrouille avec son vélo. Du coup l’homme propose de l’aider et prendre son vélo. J’hésite mais je suis coincée, j’accepte.
Il nous rend le vélo, je dis merci et là il s’approche et sussure : “ce n’est pas pour elle que je l’ai fait”. Et il me regarde de haut en bas comme si j’étais un morceau de viande.
Je n’ai rien dit, car pour l’instant je ne vois toujours pas ce que l’on peut dire dans ces cas là.
le 19 octobre, 2017 à 11 h 54 min a dit :
Merci infiniment pour cet article courageux. On se sent moins seule mais quelques secondes après, on se sent finalement encore plus seule car ça nous arrive à toutes. C’est plus répandu que tout ce que j’avais eu peur de penser. A toutes les strates de la couche sociale, à tous les âges…
le 19 octobre, 2017 à 12 h 00 min a dit :
Bravo pour ce témoignage. C’est courageux et poignant. Il ne faut pas arrêter d’en parler… Encore bravo à toi !
le 19 octobre, 2017 à 12 h 24 min a dit :
Les langues se délient, ces vérités là ont mis beaucoup de temps à exploser à la face du monde ; malheureusement quand ça touche à l’intimité, il y a derrière un grand sentiment d’impuissance, de peur, et surtout de honte…… C’est en effet en train de changer… Tous ces témoignages qui fleurissent ainsi que ton courageux article le prouvent !
le 19 octobre, 2017 à 12 h 35 min a dit :
Je ne vais pas m’étaler sur des lignes et des lignes, je voulais juste te dire à quel point j’admire ton courage d’avoir publié ce texte. Car oui c’est courageux de remuer ça et de faire le choix de l’exposer. Je suis estomaquée par ce que je viens de lire, et pourtant c’est finalement si banal malheureusement. Bref, bravo.
le 19 octobre, 2017 à 16 h 12 min a dit :
Merci pour cet article qui me permet de te connaître un peu plus et pour si bien poser les mots sur le ressenti face à ces agressions…. Puisse ce mouvement n’être qu’un début, le moment où la prise de conscience et le changement d’attitude devienne irréversible…
Habitant en banlieue “chaude” malheureusement je trouve que l’attitude de certains (jeunes) hommes empire…
(Pour le vieux porc il risque de se sentir visé assez vite ton article est déjà repris sur L’Express)
le 19 octobre, 2017 à 16 h 38 min a dit :
Joxe ?
Toujours est-il que s’il est capable de faire ça en public, de quoi est il capable dans un bureau, seul avec une jeune sans échappatoire ni famille à qui se confier … ? D’ou l’intérêt de porter plainte, pas pour soit, mais pour éviter qu’il récidive et gâche la vie d’autres filles…
le 19 octobre, 2017 à 17 h 20 min a dit :
C’est fou, ça m’estomaque et me chamboule pour toi. Tu es courageuse de tout raconter. Ca a dû être difficile et en même temps libérateur. Mais quels salauds qui se croient tout permis ! Je suis sincèrement blessée et désolée pour toi, et en même temps je prends conscience de toutes les autres femmes qui sont, comme toi, des victimes silencieuses.
Jusqu’à il y a 30 secondes, je disais que non, moi je ne me souviens d’aucune expérience. Et puis, si… Je me souviens, ado en vacances en camping comme tous les ans, dans le camping familiale et sans histoire que l’on fréquente depuis que j’ai deux ans, quelqu’un a glissé une caméra sous la cloison de ma cabine aux sanitaires, pendant que je m’épilais. J’ai repoussé la caméra puis elle est réapparue. J’étais seule et terrorisée, je ne savais plus quoi faire, je n’osais pas sortir : et s’il m’attendait dehors ? J’ai attendu sans bouger pendant un moment, tétanisée, avant de réussir à regagner ma tente en courant. Et depuis, j’ai peur dans les cabines de douche des campings. Si les murs de la cabine ne montent pas jusqu’au plafond et ne descendent pas jusqu’au sol, je suis terrorisée pendant toute ma douche : et si ça recommençait ? Cet homme m’a volé ma tranquillité au cours du moment de la journée supposé être le plus relaxant. Et je ne la retrouverai jamais. Alors finalement #MoiAussi
le 19 octobre, 2017 à 17 h 42 min a dit :
[…] Mais moi aussi, #moiaussi, j’ai besoin de vous raconter. » Ainsi débute le témoignage d’Ariane Fornia, publié sur son blog ce mercredi. Cette « écrivain-voyageuse » de 28 ans est la fille […]
le 19 octobre, 2017 à 17 h 57 min a dit :
[…] has published on Thursday a long post on his blog entitled ” #Moiaussi : for the shame exchange camp “, where she talks to three sexual […]
le 19 octobre, 2017 à 18 h 16 min a dit :
C’est dingue tout ce qui t’es arrivé et ce qui arrive à tant d’autres. Je me sens presque chanceuse de ne jamais avoir vécu ce type d’expérience (“chanceuse”, si c’est pas malheureux d’utiliser ce mot pour ce qui devrait couler de source…).
Pour la toute première fois depuis que je vis à Prague, il y a quelques jours, j’ai été appelée “pute” (bitch pour être plus précise. “Let’s fuck that bitch” ou “Fuck that bitch”. La signification n’est pas la même mais c’est clairement pas quelqu’un qui me voulait du bien). J’ai été choquée. Je ne peux donc imaginer la réaction de celles qui vivent des expériences plus choquantes.
Merci à toi et à toutes les autres qui parlent pour éveiller les consciences !
le 19 octobre, 2017 à 18 h 24 min a dit :
Pierre et moi sommes vraiment désolés et énervés que tout ceci te soit arrivé. Comme pour toutes les victimes qui témoignent depuis plusieurs jours, c’est un sentiment d’impuissance et de frustration qui naît en moi quand je lis ces témoignages… Ce problème de société doit en finir, avec de l’éducation, avec du bon sens, bordel.
le 19 octobre, 2017 à 19 h 42 min a dit :
[…] Mais moi aussi, #moiaussi, j’ai besoin de vous raconter. » Ainsi débute le témoignage d’Ariane Fornia, publié sur son blog ce mercredi. Cette « écrivain-voyageuse » de 28 ans est la fille […]
le 19 octobre, 2017 à 19 h 55 min a dit :
Arf, tes histoires sont plus horribles les unes que les autres >< Mais ce qui choque le plus dans ton témoignage, c'est de constater que malheureusement le pouvoir peut engendrer des comportements " de porc ", même chez les plus éduqués …
le 19 octobre, 2017 à 20 h 28 min a dit :
J’ai lu ton article avec attention. Que dire?! Ariane, je suis profondément triste par ce que tu as subi. J’ai vécu quelque chose de semblable dans un bus quand j’avais une dizaine d’années et je ne veux pas donner plus de détails sordides. Tu as raison. La honte doit changer de camp et le côté positif de ce déferlement c’est que cela libère la parole des femmes. Je t’embrasse!
le 19 octobre, 2017 à 20 h 32 min a dit :
[…] Mais moi aussi, #moiaussi, j’ai besoin de vous raconter. » Ainsi débute le témoignage d’Ariane Fornia, publié sur son blog ce mercredi. Cette « écrivain-voyageuse » de 28 ans […]
le 19 octobre, 2017 à 20 h 40 min a dit :
Ton témoignage me fait froid dans le dos.. Surtout le premier en fait, car j’imagine ce que tu dois ressentir aujourd’hui, le fait comme tu dis, de ne pas avoir su dire non assez fort… Forcément, comment ne pas se sentir coupable? C’est pervers et insidieux, c’est peut-être la pire des agressions, car elle ne te positionne pas explicitement comme victime.
Pourtant, tu es bien une victime. Je pense fort à toi, et te fais un gros câlin virtuel. Je te trouve super courageuse, brillante, intelligente, vive, aimante! Quelle revanche par rapport à ce que tu as pu vivre!
le 19 octobre, 2017 à 21 h 18 min a dit :
Merci pour ce témoignage poignant et digne.
le 19 octobre, 2017 à 21 h 40 min a dit :
Bravo pour votre courage.
Vous avez eu raison de parler, pour vous, pour toutes les victimes, pour les femmes en général, j’ai une fille et je n’ai pas envie qu’elle subisse ce genre d’agissements, et accessoirement pour les hommes qui ne sont pas tous des prédateurs sexuels et qui seraient soulager de voir les fruits pourris extirpés du panier.
J’espère que votre agresseur de l’opéra pourra être poursuivi et que s’il est reconnu coupable – pour l’instant par principe il est présumé innocent – il sera suffisamment puni pour que d’autres soient dissuader d’agir ainsi.
le 19 octobre, 2017 à 21 h 43 min a dit :
[…] suite, Ariane Fornia la raconte sur son blog, Itinera Magica, dans un post intitulé #moiaussi. « Au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma […]
le 19 octobre, 2017 à 21 h 43 min a dit :
Bon bah… #moiaussi. Je sais pas si ça avance à grand chose, ça m’épuise tout ça. J’ai l’impression que passé la première phase ça va redevenir comme avant…
Tiens, aujourd’hui, j’y ai eu droit. Un sifflement d’un type, depuis sa camionnette de fonction. Je l’ai engueulé comme du poisson pourri. Ca a servit à rien : demain, il recommencera avec une autre, parce que ça l’amuse. Bah oui : “Aucune fille s’est plainte jusqu’à présent. Arrête de me manquer de respect en m’engueulant”.
le 19 octobre, 2017 à 21 h 59 min a dit :
Alexandra, quelle rage on éprouve à lire ton récit de cette abominable soirée d’opéra.
Bravo pour oser le dire, l’écrire sans rien en cacher.
Toutes les femmes se sentent salies et blessées avec toi mais aussi, fort heureusement beaucoup d’hommes en prennent conscience et en sont bien attristés.
Toute mon amitié.
le 19 octobre, 2017 à 22 h 13 min a dit :
[…] Fornia, écrivaine et fille de l’ancien ministre Éric Besson, raconte sur son blog avoir été agressée sexuellement par Pierre Joxe, un ancien éminent ministre de François […]
le 19 octobre, 2017 à 22 h 22 min a dit :
Oser évoquer ainsi les agissements d’un homme puissant: quel courage. Bravo pour ce témoignage très fort même si, en même temps, je suis vraiment effaré de l’agression qui vous a été imposée. Soyer fière de vous pour l’exemple que vous donnez et qui ne manquera pas de nourrir ce processus salvateur et inédit: une démarche de salubrité et pour les femmes et pour les hommes qui sont aussi frustrés de l’ambiance que provoquent certains de leurs congénères par leurs propos et leurs attitudes détestables. Une nouvelle ère commence grâce au courage des femmes. Merci.
le 19 octobre, 2017 à 22 h 29 min a dit :
Finalement je ne pouvais plus attendre fallait que je le lise … personne ne devrait vivre de telles choses PERSONNE et pourtant ça nous est toute arrivé et #moi aussi ! Tu as eu du courage de tout écrire comme tu viens de le faire et de dénoncer tous ces actes horribles … je ne prie que pour un monde meilleur tout comme toi ! Toutes mes pensées vont à ses femmes qui ont endurci toutes ces dures épreuves <3 pitié que tout ça s'arrête un jour!
le 19 octobre, 2017 à 22 h 52 min a dit :
Merci. Vraiment merci …
Dans ma jeunesse j’ai réussi à gérer comme j’ai pu ce genre de propositions, harcèlements, menaces voilées, agressions, peurs, goujateries et j’en passe …
Mais avec le temps cela a fini par me détruire. Résister une dernière fois et éconduire un dernier patron (accessoirement élu du médef) “qui me voulait du bien”, ancien copain de fac dont j’ignorais qu’il attendait son heure depuis plus de 35 ans en m’embauchant, m’a été fatal en représailles, aussi bien à ma carrière qu’à ma santé.
Il faut savoir que ce genre d’individu ne s’attaque qu’à une proie dont il a évalué l’état de faiblesse momentanée. Jamais à une proie qui peut se barrer en faisant un scandale.
Oui j’ai su dire NON et OUI je l’ai chaque fois payé très cher et OUI il faut que cela cesse !!! NON je n’ai jamais été soutenue par des confrères ou collègues (masculins ou féminins) qui réalisaient que m’approcher ou s’inquiéter de mon sort équivalait à se mettre en péril eux-aussi.
Ma fille ? elle est magnifique à tous point de vue ! Mais j’ai assuré son éducation et son indépendance et elle est bien briefée sur la question et capable de se constituer un dossier en béton à la moindre alerte et de ne pas hésiter à tout balancer, voire même de répliquer par “tous” les moyens. C’est sa force et personne ne l’emmerde. C’est ce qu’il faut apprendre aussi à nos filles pour que nos destructions ne soient pas vaines.
Encore merci.
le 19 octobre, 2017 à 23 h 20 min a dit :
[…] a publié ce jeudi un long billet sur son blog intitulé « #Moiaussi : pour que la honte change de camp », où elle évoque trois […]
le 20 octobre, 2017 à 0 h 08 min a dit :
[…] ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Besson. Au travers d’un article publié mercredi sur un blog, la jeune femme de 28 ans avoue avoir été victime de différentes agressions sexuelles. […]
le 20 octobre, 2017 à 0 h 37 min a dit :
[…] ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Besson. Au travers d’un article publié mercredi sur un blog, la jeune femme de 28 ans avoue avoir été victime de différentes agressions sexuelles. […]
le 20 octobre, 2017 à 1 h 10 min a dit :
C était L’Or du Rhin… J y étais, plusieurs fois, j’adore Wagner… Je suis profondément désolée …
le 20 octobre, 2017 à 2 h 42 min a dit :
Ces hommes de pouvoir qui se croient intouchables, il ne faut pas leur faire de cadeaux. C’est très grave un tel comportement. Cela doit immanquablement impacter leur carrière politique ou professionnelle. Les femmes doivent dénoncer sur l’instant, créer un scandale public. Idem sur la voie publique. Ne rien laissez passer et surtout les forces de l’ordre doivent dresser des contraventions immédiates pour tous ces actes d’incivilité. Parce qu’une main déplacée ne pourra jamais donner lieu à une réparation devant les Tribunaux. Les Tribunaux ne parviennent déjà pas à juger des affaires de viols dans des délais raisonnables. Si les femmes s’insurgent, crient, vocifèrent, il y aura des hommes pour les défendre dans l’espace public. Soyons solidaires contre les incivilités de tout genre et surtout “Name and Shame”.
le 20 octobre, 2017 à 6 h 07 min a dit :
Merci 1000 fois pour que la honte change de camp.1974 j’avais 20 ans je n’ai pas su voir que cet homme qui me proposait du mannequinat avait de toute autres intentions.Je n’ai jamais raconté cet épisode…les années 70 la liberté sexuelle etc J’AVAIS HONTE.
Maintenant je suis inquiète pour mes deux petites filles de 7 et 4 ans et j’essaie de leur apprendre à dire NON et à dénoncer à parler quand on leur fait quelque chose et qu’elles ne sont pas d’accord.
Il y a 3 jours la directrice de l’école maternelle de la petite a appelée une amie de ma fille pour l’informer que sa petite fille de petite section a subit des attouchements de la part de deux garçons!
Je suis effarée il est plus que temps d’agir ces enfants sont en danger.
QU’ON ARRETE DE MINIMISER DE PARLER DE SEDUCTEURS,D’HOMMES A FEMMES,DE BLAGUES ETC.Tant qu’on défendra les Polanski,les Woody Allen etc etc la société reçoit des mauvais signes et ne fait plus de différence entre le bien et le mal.Même le président qui utilise des qualificatifs insultants dans ses discours et les justifie clairement participe au délitement de notre société.
le 20 octobre, 2017 à 6 h 57 min a dit :
Et bien voilà un article puissant qui a déjà l’air de remuer le monde médiatique. Quel courage tu as. J’espère que l’effet de groupe sera porteur et fera changer les choses. De la petite humiliation à l’agression, toutes ces attaques nous réduisent peu à peu au silence. J’ai toujours eu honte d’avoir honte #moiaussi, et seule l’éducation pourra jouer. Mais je ne suis pas optimiste
le 20 octobre, 2017 à 7 h 56 min a dit :
Je suis un homme mais dans mon enfance et mon adolescence, j’ai subi quelques agressions sexuelles qui sont certes moins graves que celles subies par la plupart des femmes. Néanmoins, cela a suffi pour me dégoûter de ce que l’on appelle la virilité et me faire évoluer vers une sorte de transgendérisme militant: je m’habille souvent en fille. Je rejette évidemment le qualificatif de “travelo” ou “travesti” et je reste hétérosexuel.
A vrai dire, je m’intéresse depuis longtemps au féminisme de la seconde vague et aux études de genre qui m’ont permis de comprendre le fonctionnement du patriarcat.
Je recommande à tous, et en particulier aux hommes, la lecture de cet ouvrage “Refuser d’être un homme” de John Stoltenberg. Il est temps de déconstruire la virilité.
le 20 octobre, 2017 à 8 h 06 min a dit :
:*(
le 20 octobre, 2017 à 8 h 30 min a dit :
Tout mon soutien <3
Je pense qu'on est nombreuses à avoir vécu ça, mais aussi à s'être tue surtout étant plus jeune. Parce qu'on en parlait pas, ou à l'inverse parce qu'on ne disait pas assez que la honte ne devait jamais être du côté des victimes. Maintenant, je me sens plus aguerrie face à tout ça, même si je me sens aussi complètement vulnérable parfois. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'on "parle" enfin. Le problème est enfin exposé. Et on commence enfin à lire, à côté de la merde de certains trolls, de plus en plus de gens rappeler qu'une victime est une victime, point.
le 20 octobre, 2017 à 8 h 31 min a dit :
dommage de ne pas avoir pris la parole avant, mais il faut que toutes les filles ou femmes qui sont victimes de harcèlement, de comportement anormaux de tous ces frustrés parlent …ce n’est pas vous qui êtes coupable, ce sont eux les salauds…
100% de soutient à toutes celles qui parlent car d’autres qui n’osaient pas le faire vont parler aussi..
dénoncez aussi ce que vous voyez autour de vous (travail, etudiant sport etc), ne restez pas silencieuse, pour les Hommes et les Femmes qui voient tout cela et qui ne disent rien vous savez ce que j’en pense…
le 20 octobre, 2017 à 8 h 57 min a dit :
[…] que la honte change de camp ». Sur son blog, l’écrivaine Ariane Fornia, fille de l’ex-ministre sarkozyste Eric Besson, raconte plusieurs […]
le 20 octobre, 2017 à 9 h 06 min a dit :
Bonjour,
Merci pour votre témoignage. Je pense que dans le milieu médicale, pas mal de jeune médecin ou d’interne sont aussi harcelée. Aucune n’ose parler maintenant, il faut les aider à liberer leur parole.
Bon courage.
le 20 octobre, 2017 à 9 h 11 min a dit :
Bravo
le 20 octobre, 2017 à 9 h 37 min a dit :
[…] avoir longuement hésité, l’écrivain de 28 ans se livre dans un billet posté sur son blog et intitulé #Moiaussi: pour que la honte change de camp. Alors qu’elle révèle avoir été […]
le 20 octobre, 2017 à 9 h 39 min a dit :
que la jusitce bouge, que les mentalites bougent, que les gens bougent, que la peur passe dans l’autre camp , pauvre ou puissant point barre pour toute agression PEINE EXEMPLAIRE
bravo MME et honte a ceux qui dedramatisent
le 20 octobre, 2017 à 9 h 43 min a dit :
[…] suite, Ariane Fornia la raconte sur son blog, Itinera Magica, dans un post intitulé #moiaussi. « Au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma […]
le 20 octobre, 2017 à 9 h 45 min a dit :
Je compatis vraiment car oui…nous avons TOUTES une ou des histoires enfouies dans notre cerveau comme la #poussièresousletapis. Ce qui me surprend, me choque, me met en colère ce matin 20 novembre ce sont les commentaires des internautes sur la page Facebook du Figaro : Beaucoup sont négatifs …c’est vraiment un symbole…la France n’est pas prête à réagir sainement face au harcèlement et le #elle l’a bien cherché cette put n’est pas mort:-(
le 20 octobre, 2017 à 9 h 49 min a dit :
Bonjour et merci pour votre témoignage. Je vous envoie du courage, tenez bon aux réactions qui font du mal, genre “mauvais canular”.
le 20 octobre, 2017 à 10 h 00 min a dit :
Je suis bouleversée par ton témoignage car il m’est arrivé une histoire en tout point similaire à la tienne.
#moiaussi
le 20 octobre, 2017 à 10 h 29 min a dit :
Bravo! C est courageux et utile de dėnoncer ces hommes à double morale. Le coté public et bien sous tout rapport, souvent moraliste et le vrai côtė, qui abuse de sa puissance ou age ou position …Merci Et honte à ceux qui doutent… quel intérêt y aurait il à se faire de la pub sur un sujet si lourd et triste.
Comme souvent, si l on a pas vėcu cette experience, elle est difficile a imaginer, a comprendre. L impact de ces abus est tres important même lorsque le délit ne va pas jusqu au plus GRAVE.
Concernée aussi à trois reprises, les souvenirs s effacent mais l effroi Reste.
La première fois, j ai 8 ans, je joue devant chez moi , ambiance non mefiante, deux jeunes hommes m attirent dans un hall avec un mensonge et m immobilisent, m embrassent de force , commencent à aller plus loin, je dis que mon père dois arriver… Je hurle ils s enfuient, je reste plusieurs mois très choquée et peureuse.
Ensuite j ai 10 ans, le père d’une amie chez qui j étais allé dormir. Prof d universitė, soit disant humaniste, il nous fait prendre une douche et cela me paraît bizarre mais je suis pétrifiée? Il nous lave, je suis paralysée. Le soir il nous fait dormir dans son lit et à des gestes déplacés. Je suis comme impuissante et réussie tout de même à me réfugier aux toilettes. Ensuite dans mon souvenir cela s est arrêté.
Il faut insister sur le fait que souvent lors de ces événements il y a une inégalité de départ : âge, hiérarchie, aura, qui fait que l on doute de soi même, on doute du délit ou de sa rėalité. En tant qu’ enfant, le caractère anormal peut nous échapper. Il circule dailleurs en ce moment une pétition sur la non prescription des délits de pédophilie.
Et la dernière fois qui m à marquée, j ai 13 ans et un prof de collège de francais me propose d aller au théâtre avec une amie. Au dernier moment l amie décommande. Le prof me dit on va passer chez moi, prendre les billets’ et la il me prend la main et essaye de m embrasser. Je réussie à dire non et à partir mais Je me dis je me suis encore fait avoir, je n ai rien vu, je le regrette encore.
Adulte, d autres exemples, ….comme beaucoup d amies ….j ai même eu droit à un voisin qui prenait plaisir à proposer ses services nu face à ma fenêtre, j ai fini par vivre volets fermés et à déménager. ..
A aucun moment je n ai pu dire ma colère de ces abus qui peuvent polluer les relations aux hommes à l amour, la confiance. J en garde Une méfiance et une crainte qui demeurera.
Heureusement mon mari est d une douceur et d une bienveillance qui m’a un peu reconciliee avec le masculin, mais je fais encore des rêves ou je crie sans que l on m entende, comme étouffée. Ma peur est qu aujourd hui je n arrive pas à extérioriser mon refus ou à me défendre.
Je vois certains regards sur ma fille de 11 ans, de retour de vacances, dans notre quartier moitié bobo moitié populaire, lorsqu elle est en jupe genou ou robe d ėtė, qui sont vraiment écoeurants. On a pris la habitude de moins montrer, d enfiler le jean et les basket pour avoir la paix. C’est pire pour les ados des quartier très populaires qui nous entourent, elles se protègent dans une armure soit de jeans à sexué basket pull soit pire de voile…. j avais l idée en tant que femme plus mure (45ans) de les aider indirectement en portant jupe, décolleté, petit talon pour défendre notre liberté. Car on a tendance à se autoadapter et à restreindre notre liberté pour ne pas être embêtée. Je ne parle pas de mini-jupe et strings qui dépassent, je parle de tenue normale et difficile à porter à 100metre de Paris.
C’est bon signe que la parole se libère. Et tout en comprenant les craintes de dénonciations calomnieuses, je pense que les abus sont largement sous estimés, tus et ont un impact si fort que il est plus important de les dénoncer publiquement que de se soucier de l image des abuseurs.
le 20 octobre, 2017 à 10 h 35 min a dit :
[…] un post intitulé « #moiaussi : pour que la honte change de camp », publié sur son blog et repéré par L’Express, Mme Fornia raconte plusieurs agressions sexuelles dont elle dit avoir […]
le 20 octobre, 2017 à 10 h 38 min a dit :
BRAVO Ariane d’avoir osé parler! Evidemment que votre témoignage ne fait aucun doute, malgré la réaction outrée du monsieur: “comment? moi?! vous parlez de mooooa?!”.
J’espère que les pervers y réfléchiront à deux fois la prochaine fois avant de se croire tout permis.
La honte doit changer de camp.
le 20 octobre, 2017 à 10 h 39 min a dit :
Bonjour,
un petit mot pour saluer votre courage et espérer que votre déclaration vous offrira un petit soulagement.
Je n’ai rien vécu de tel à titre personnel mais (comme peut-être 90% de la population) plusieurs de mes proches directs et indirects ont vécu ce genre de choses à divers degrés de perversité et de violence.
Certains gestes peuvent sembler légers au regard de la loi, c’est-à-dire ne pas donner lieu à une suite judiciaire mais la douleur et la souffrance ressenties sont très personnelles et peuvent sembler “disproportionnées” au regard de gens non avertis.
Votre témoignage a donc autant de valeur que bien d’autres…
Paradoxalement, il y a de fortes chances pour que soit vous à qui la justice demande à s’expliquer ( ça m’est arrivé, suite à un signalement de ma part, après un non lieu…) mais vous, moi et plein, plein de gens savent que vous dites la vérité et que vous souffrez encore de ce qui vous est arrivé.
Alors merci pour vous-même car vous initialisez quelque chose qui va vous soulager vous et votre famille et merci pour toutes les autres victimes à qui vous donnez une bouffée d’air.
Bien Cordialement.
le 20 octobre, 2017 à 11 h 03 min a dit :
Bravo Ariane ! Grand courage pour un témoignage très fort, si sensible. Et moi aussi j’ai tout le temps peur pour ma fille de 20 ans ! Que la peur et la honte changent de camp. MF 65 ans.
le 20 octobre, 2017 à 11 h 10 min a dit :
[…] avoir longuement hésité, l’écrivain de 28 ans se livre dans un billet posté sur son blog et intitulé #Moiaussi: pour que la honte change de camp. Alors qu’elle révèle avoir été […]
le 20 octobre, 2017 à 11 h 22 min a dit :
#Moi aussi.
Et je ne suis pas une femme.
C’est simple et triste : tous ceux qui sont vus comme faibles ou attirants sont victimes d’agressions – sexuelles ou non, hommes et femmes.
Le problème est très large…
le 20 octobre, 2017 à 11 h 37 min a dit :
[…] site de L’Express, qui explique que l’écrivaine relate toute son histoire sur son blog, Itinera Magica, dans une publication intitulée […]
le 20 octobre, 2017 à 11 h 54 min a dit :
l’ancien ministre nie et vous maintenez votre version donc question: que fait on?
Comment le prouver? Puisqu’il est impossible de trouver une quelconque preuve matérielle? La solution c’est malheureusement c’est de savoir s’il existe d’autres cas d’agression de la part du monsieur incriminé. Faire un truc pareil ne s’improvise pas. Il l’a déjà fait avant, pas forcément à l’opéra peut être des anciennes assistantes. Il va falloir enquêter.
Pour ce qui est du metro, le jour où on autorisera les femmes a porter de façon apparente un taser (et qu’on leur auaorisera à taser les burnes des pervers), croyez moi que bien des frotteurs ou d’autres lubriques passeront leur chemin.
Pour conclure il faudra un moratoire sur le pornographie en EUROPE:
Je n’ai rien contre les films qui montrent des actes sexuels consentis, les calins, les scènes de déshabillage, les passages érotiques mais en tant que consommateur occasionnel, je suis de plus en plus dégouté par cet univers. Je m’explique: de plus en plus les films pornos sont violents, très violents, on met en scène des séquences qui sont moins des actes sexuels que des agressions les plus brutales. Pas plus tard que ce matin je suis tombé sur des videos (fake) disponibles sur pornh*b qui montrent des mise en scène de papy frotteurs… Bien évidemment c’est une mise en scène mais cela pose problème en terme éthique. Quel impact cela a t’il sur des consommateurs réguliers? Personellement, en tant que consommateur ponctuel, je préférerai ne plus voir ça et voir des films plus plans plans, classique. Là cela devient vraiment n’importe quoi et je me demande si ça n’incite pas à force les hommes à adopter des comportements irrespecteux envers les femmes. A creuser donc. Voilà c’était mon coup de gueule.
le 20 octobre, 2017 à 12 h 07 min a dit :
Bravo madame Fornia. Quel courage ! il faut que la honte change de camp….ça suffit
le 20 octobre, 2017 à 12 h 19 min a dit :
[…] Arian Fornia se dit « soulagée » de s’être confiée. « Continuons le combat », conclut la jeune femme sur son blog. […]
le 20 octobre, 2017 à 12 h 21 min a dit :
J’admire ton courage pour écrire cet article. Malgré ce grand mouvement qui changera peut-être certaines choses, je n’ose pas écrire. Ces instants sont restés dans ma mémoire, m’ont fait mal c’est certain mais je n’ai pas envie de les revivre en écrivant. Ces instants m’ont donné aussi une sale image des hommes, quelques-uns m’ont aidée à changer cette image, mais je crois qu’elle est toujours au fond de moi.
Je ne m’attendais pas que la petite itinera Magica que je suis depuis un moment soit cette jeune fille qui dénonce ce ministre avec tant de courage.
Je suis admirative.
Bises
le 20 octobre, 2017 à 12 h 25 min a dit :
J’ai moi aussi subi toute ma jeunesse des agressions sexuelles parfois violentes et j’ai porté ma « beauté » comme un fardeau à cause de ces agressions.
J’ai été harcelée par un rédacteur en chef qui m’a clairement dit que pour garder mon job de journaliste je devais y passer aussi (d’apres Ce qu’il m’a dit il y avait plusieurs journalistes soumises). J’ai refusé. Quelques jours plus tard je n’avais plus de bureau, personne ne me parlait à la rédaction, comme si j’etais Pestiférée. J’ai cherché un autre job, à mi temps. Il l’a appris et il m’a virée par téléphone en me menaçant et en me jurant (il hurlait il était hystérique) qu’il grillait ma carrière et que Paris était un petit village, que plus personne ne me ferait travailler.
Il a tenu sa promesse et j’ai dû quitter le journalisme parce qu’il m’a grillée et blacklistee.
En sortant du milieu journalistique, j’ai été confrontée à d’autres prédateurs.
Je me suis dit que c’etait un pays pourri, parce que c’est vraiment partout et les femmes portent leur beauté comme un lourd fardeau. Rien n’est fait pour nous aider. C’est écoeurant.
Aujourd’hui ce monsieur est encore journaliste (SR), écrivain, il travaille au Nouvel Observateur après avoir sévi à Elle, là où j’étais. Incroyable ironie de ce journal féministe qui a laissé un prédateur œuvrer sans rien dire.
le 20 octobre, 2017 à 12 h 32 min a dit :
[…] un post de blog intitulé « #moiaussi : pour que la honte change de camp », Ariane Fornia raconte plusieurs […]
le 20 octobre, 2017 à 12 h 35 min a dit :
Enfin enfin les femmes parlent ! Ah ça dérange ce déferlement et plus d’un doit trembler dans ses braies à l’idée de voir son nom à la Une !
Il se dit que la génération des papy-mamy trouve ça plus “normal” que la jeune génération. C’est faux, du moins en ce qui me concerne (et je ne suis pas la seule). J’ai toujours trouvé inadmissible ces comportements de prédateurs. Encore maintenant (on est bien “conservé” même à 60 ans de nos jours) il m’arrive de subir une main aux fesses : c’est systématiquement suivi d’une gifle. Un jour tu te feras tuer” m’a-t-on déclaré.
Plus jeune, je ne me laissais pas faire non plus et ne me privais pas d’invectiver le type qui en général ne demandait pas son reste. Le coup de genou (très efficace) dans le paquet, je connais aussi. Les griffures et morsures également. Tout était bon pour me défendre. Je n’en parlais pas chez moi depuis le jour où, ayant dit à mon père qu’un mec m’avait mis la main au panier, il m’avait répondu : “TU avais fait quoi pour que ça t’arrive ?” Parce que bien entendu, c’était de ma faute.
C’est toujours de notre faute : nous sommes des tentatrices, des messalines, des diablesses perverses, au choix des garces ou des salopes selon qu’on cède ou non.
Au lieu d’éduquer les petits garçons, on préfère bâcher les filles, leur apprendre à se vêtir et à se comporter “comme il faut” parce que les hommes sont “comme ça” ! Comme ça : tous des porcs, des salauds ? Heureusement que non !
Il faut, oui, il faut que la honte change de camp. Il n’y a pas de honte à avoir parce qu’on est une femme (un homosexuel ou un enfant) harcelée, violentée, forcée. En revanche il y en a à se conduire comme un soudard.
Il ne faut rien tolérer : ni la blague lourdingue, ni la main baladeuse, ni, a fortiori le contact imposé, le baiser forcé.
le 20 octobre, 2017 à 12 h 54 min a dit :
[…] un billet de blog intitulé « #Moiaussi : pour que la honte change de camp », la jeune femme raconte plusieurs […]
le 20 octobre, 2017 à 13 h 47 min a dit :
J’admire et je salue votre courage. Cet homme doit être puni. Que ce soit un ancien ministre ne change rien ! On ne se comporte pas ainsi avec une femme . On ne se comporte pas ainsi avec un homme également (même si ce n’est pas le cas ici ) . Il faudrait éduquer un peu mieux les être humains et que ces derniers apprennent à maîtriser leurs pulsions sexuelles .
le 20 octobre, 2017 à 14 h 21 min a dit :
Grande voyageuse, photographe depuis environ une petite dizaine d’années, j’ai moi-même été confrontée, à de trop nombreuses reprises et pas uniquement dans un contexte de voyage, à des agressions allant de l’indélicatesse, de la simple remarque déplacée, jusqu’au passage à l’acte.
Je ne souhaite pas ici raconter ne serait-ce que quelques-unes de ces expériences qui toutes, même si à des degrés divers, ont laissé des traces car là n’est pas mon propos.
Ce que je souhaite en revanche dire, c’est que, bien souvent, la plupart du temps, j’ai réagi : je suis allée porter plainte lorsque la situation a exigé que je le fasse ; je me suis parfois physiquement défendue (et je suis plutôt du genre poids plume) ; j’ai alerté en hurlant lorsque je ne pouvais rien faire d’autre ; j’ai verbalement, et parfois publiquement, rendu à son propriétaire l’humiliation qu’il venait de me faire subir et, dans ces cas-là, la colère aidant, je peux vous assurer que j’ai, disons, le verbe haut et cru.
Bien souvent, la plupart du temps, mais pas à chaque fois. En effet, il m’est arrivé, parce qu’alors littéralement sans voix, de me taire face à celles de ces agressions qui sont bien plus subtilement décelables et se posent un peu là, comme ça, sans en avoir l’air. Je fais ici référence à ces petites indélicatesses, qui ne sont souvent que verbales, commises non seulement par des hommes mais aussi par des femmes, au sein du cercle familial, amical, conjugal, entre collègues, entre voisins, entre patients et médecins, entre amants, etc… et qui disent tout autant sinon peut-être davantage qu’une main aux fesses ou qu’un regard dégoulinant de convoitise, ce machisme latent, ordinaire et universellement répandu, savamment entretenu depuis des siècles.
le 20 octobre, 2017 à 14 h 49 min a dit :
Bravo pour votre courage, car il en faut une sacrée dose pour oser passer de l’autre côté de la barrière , ce courage je ne l’ai jamais eu , j’ai préféré changer de région et renoncer à mes activités culturelles quant j’étais jeune et aujourd’hui à 50 ANS , beaucoup de regrets mais un grand espoir souffle depuis quelques jours , la peur et la honte vont peut-être changer de camp !
le 20 octobre, 2017 à 15 h 41 min a dit :
Très courageux, merci Ariane. Moi j’ai été violée par mon père entre 6et7 suivi d’un acte barbare plus traumatisant que le viol en lui-même. Amnésie totale par effroi et peur. Des années plus tard, j’avais la trentaine déjà et une vie impossible à gérer : dépressions, des flashes, une analyse, une expertise : pas de doute. Mais personne famille ou amies, ne m’a soutenue. Un désert. Mais revenons en arrière : A 17ans en 1974 j’étais montée à Auxerre pour passer des tests pour entrer dans une école d’infirmière : à la gare comme j’étais en avance pour un RV, alors que j’attendais dans le hall un peu avant de sortir de la gare, je fus abordée par un homme qui m’invita à boire un café dans le café à gauche de la gare en sortant de la gare. Je ne voyais pas le mal, j’étais heureuse de réussir, de me lancer dans la vie malgré le fait que je ne me sentais pas bien au fond de moi. Une fête pour moi. Une fois dans le café, assise sur une banquette à côté de l’homme à ma droite, au bout de qq mn, soudainement, un bloc d’angoisse, j’ai ressenti une violente douleur dans le ventre : l’homme avec son poing passé par-dessous la table m’appuyait de toutes ses forces sur le ventre. Je regardais hébétée et horriblement honteuse, choquée, en direction de la femme qui tenait le bar. Je faisais tout pour retenir un cri alors que je voulais appeler au secours. Tellement honteuse que j’ai soufflé dans une respiration coupée que je voulais partir. On s’est levé. L’homme m’a dit “vous ne voulez pas monter dans mon car ? je suis chauffeur de car”. J’ai répondu “non, j’ai des examens à passer”. Je n’avais que 17ans, très fragile, j’avais préféré oublier cela. Sauf que qq années plus tard, des faits médiatisés m’ont choquée, et ont contribué à me destabiliser. Plus tard aussi dans le métro, à Paris, un homme s’est frotté contre moi : coincée entre les voyageurs, impossible de me dégager. Mais j’avais un parapluie, et lorsque le type descendit du wagon, j’ai levé mon parapluie pour le frapper devant tout le monde, j’étais rouge de honte, mais je m’étais défendue. Plus tard, un ami du fiancé d’une amie voisine m’a coincée dans un couloir d’immeuble alors qu’il allait voir mon amie : je me suis retrouvée au sol et, alors qu’il était sur moi, j’ai dit “Tu arrêtes tout de suite, il est encore temps pour toi, sinon tu auras à faire à la police” il s’est relevé, a présenté ses excuses. Plus tard, un jeune homme s’est masturbé devant moi alors que je promenais mon chien, je lui ai dit “mais c’est triste, je te conseille fortement d’aller voir un médecin, tu aurais à faire à qqn d’autre que moi, tu irais en prison”. Les années ont passé, ma vie a été détruite complètement à cause de ce que j’ai subi dans l’enfance : j’ai frôlé le pire psychologiquement à plusieurs reprises. Il m’a fallu lutter pour ne pas sombrer, me protéger. Ne pas parler à n’importe qui, n’importe comment, trop fragile. Ici, je me suis avancée un peu plus. Peut-être parce que j’arrive à la retraite et que le gâchis me tue. Bon, ceci dit pour que les choses évoluent pour les autres : mais je dis aussi que ce n’est pas parce que l’on ne parle pas que l’on est lâche, il faut être prêt, fort dans sa tête, et cela demande plus ou moins de temps, voire des années, selon l’intensité des chocs. Merci Ariane.
le 20 octobre, 2017 à 16 h 17 min a dit :
bravo. c’est bien de prendre la parole publiquement, et c’est la seule solution pour que cela cesse : ne pas se taire.
j’espère que votre goutte d’eau contribuera à faire évoluer les mentalités.
le 20 octobre, 2017 à 16 h 17 min a dit :
J’avais raté ce billet sur ton blog et je viens de voir que Le Monde relaie… Je ne me suis jamais ruée aussi vite sur un billet pour commenter et te dire mon soutien. J’ai été agressée à plusieurs reprises comme beaucoup, dans la rue, dans le tram par des inconnus ou, de manière bien plus sordide, par le frère d’une amie et par un membre de la famille.
Je n’ai jamais osé brandir ces agressions à la face des concernés ni même en parler à plus d’une copine à l’époque, qui du haut de ses dix ans, avait décrété que je me faisais des idées. Par peur de détruire des familles, sans penser alors que c’est moi que je détruisais en me taisant, et que 20 ans plus tard, je rumine une rage immense. Je ne peux que louer ton courage de parler publiquement d’un agresseur très probablement influent. Nous sommes toutes avec toi, quoi qu’en dise cette société du viol qui accorde plus de poids aux agresseurs qu’aux victimes. #moiaussi #avectoi
le 20 octobre, 2017 à 17 h 00 min a dit :
Eh bien…, voici enfin le moment d’être entendues.
Pour la faire brève, un viol tous les dix ans environ.
Première fois à cinq ans, par un inconnu qui m’a coincée dans le hall d’un immeuble que je devais traverser pour aller à l’école – hall encore à ce jour protégé des regards par des vitres si sombrement fumées qu’elles ne laissent rien percevoir depuis l’extérieur.
Deuxième fois à treize ans, par le fils d’un couple ami de mes parents, impuni et qui malheureusement le restera.
Troisième fois à trente et un ans, par un collègue qui me ramenait “charitablement” chez moi après une sympathique soirée entre collègues.
Quatrième fois il y a moins de six mois, à quarante-six ans, par un monsieur qui m’avait été présenté par un ami, lequel s’était désisté d’un rendez-vous pour affaires au dernier moment.
Sans compter les innombrables types de harcèlement, au travail, dans la rue, partout, trop souvent.
Il est temps que ces personnes qui s’arrogent le droit d’em… quiquiner les femmes apprennent à prendre conscience qu’elles ne sont pas des objets, mais des êtres libres et autonomes ; qu’ils apprennent à gérer leurs hormones (sans vouloir être délibérément grossière, ils ont deux mains, donc dix doigts, pour cela, au pire) ; qu’ils apprennent que lorsqu’une femme est “libre” – comprendre dépourvue de compagne ou de compagnon – , elles ne sont pas des places de parking, elles ont leur mot à dire ; qu’ils apprennent enfin que ce n’est pas parce que l’on se trouve “premier sur la liste d’attente” qu’ils ont une quelconque priorité.
Marilyn Monroe disait “I hate the idea of being a thing” : “je déteste l’idée de n’être qu’une chose”.
C’est notre cas à toutes, et à tous les hommes qui, à leur âge de garçon, n’ont été vues et urilisé-e-s comme des objets sexuels.
CA SUFFIT !!!!!!
Il est temps en effet que la honte change de camp, et que l’humanité entière honnisse ceux qui la rabaissent plus bas que des animaux. Ceux-là devraient être comme au moyen-âge être mis au pilori, désignés visage découvert au rejet de tous ceux qui, eux, ont gardé une âme, un coeur, un sens du respect de ce et ceux qui les entourent.
Il est temps de rétablir l’humanité et la compassion, et l’empathie, parmi les valeurs primordiales de l’éducation de tous les petits qui arrivent parmi les “grands”, et des “grands” qui doivent avoir à l’esprit que “noblesse oblige”. Le pouvoir, la richesse, doivent servir à élever ceux qui n’ont pas la chance d’être “grands”.
Rendons à notre espèce ses lettres de noblesse authentiques, celles du coeur.
Pour que ces horreurs quotidiennes cessent. Pour qu’hommes et femmes puissent s’apporter leurs différences, s’en nourrir, s’en enrichir et en enrichir ceux avec qui ils sont en contact, et le faire dans un respect mutuel. Pour que des adultes dévoyés cessent d’abuser d’enfants qui n’ont aucun moyen de se défendre. Pour que la loi du plus fort cesse d’être la meilleure. Pour que l’harmonie soit enfin autre chose qu’une utopie.
le 20 octobre, 2017 à 17 h 03 min a dit :
MOI AUSSI J AI SUBI DU HARCELEMENT SPYCHOLOGIQUE PHYSIQUE DU VERITABLE TERRORISME
LES CONSEQUENCES SONT DESASTREUSES TOUTES LES FORMES DE HARCELEMENT SONT CONCERNES
le 20 octobre, 2017 à 17 h 22 min a dit :
Un instant après ce premier commentaire, j’y reviens.
Je propose l’absence de délai de prescription.
Ce type de crime tue la vie dans la vie. On porte cette honte chaque jour. Que l’on soit homme ou femme ce type d’agression reste incrusté sa vie durant. Espérance de vie en France : plus de 80 ans. Les victimes portent cette douleur toute leur vie. Pourquoi les agresseurs bénéficieraient-ils d’une date de péremption ? Au nom de quelle “humanité”, eux qui en sont exempts ? Jusqu’au dernier jour de leurs vies, on devrait pouvoir les poursuivre, les mettre face à leur(s) crime(s). Il est déjà si difficile de dire cette honte mal placée lorsque l’on lutte avec, et eux devraient pouvoir passer l’éponge au bout d’un certain temps ? Où est la notion de justice ?
Faut-il au nom de plus de dix mille ans de machisme étouffer l’expression d’une souffrance infinie, que ce soit celle de femmes ou d’hommes ?
Quand pourra-t-on enfin cesser d’affronter des quolibets lorsque l’on dénonce un abus ?
Pour les femmes c’est peut-être un peu plus “facile” – on sait qu’elles sont bien souvent victimes du machisme ambiant. Mais tous ces hommes, dont heureusement peu à peu la parole se libère, que les commentaires culpabilisants tendent à leur faire penser qu’ils sont des “sous-hommes” ?
Les seuls “sous-hommes” sont ceux qui agressent, profitent, méprisent et tuent une deuxième fois, après ce premier meurtre que constitue l’agression, et qui vont souvent jusqu’à nier la responsabilité de leurs actes. Ceux-là ne sont que des êtres vivants – et NUISIBLES, des pestes en somme, au sens bactériologique du terme.
Alors, à quand un pesticide contre ces – ces déchets ? (je reste polie)
Que la honte change enfin de camp. Merci à toi qui as dénoncé vigoureusement et ouvertement ce type d’agissements. Sache que nous sommes, derrière toi, et avec toi, une armée révoltée contre la bassesse, et que nous porterons haut ta parole. Quand la vérité et la liberté creusent leur chemin, rien ne peut plus les arrêter. Merci, merci, merci.
le 20 octobre, 2017 à 17 h 42 min a dit :
[…] postare publicată pe blogul ei, intitulată “#moiaussi”: fie ca ruşinea să-şi schimbe […]
le 20 octobre, 2017 à 18 h 51 min a dit :
Bravo pour votre intervention à Quotidien ! Je vous admire très sincèrement car je ne pense pas que vous soyez très à l’aise pour reparler de tout ça…
J’espère que vous serez un déclencheur pour que les femmes osent enfin parler et que cette société phallocratique révise enfin ses bases ! Les femmes sont fantastiques et méritent bien mieux que ça !
De tout coeur avec vous, je vous souhaite une excellente continuation !
PS: une suggestion pour que la femme fasse un pas de géant
http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/20/171020080633819391.jpg
le 20 octobre, 2017 à 18 h 57 min a dit :
bonsoir,
je suis de tout coeur avec vous, j’ai de filles adorées Marjolaine et Amaryllis
je lui couperai les couilles à ce vieux pervers
si l’on touche à mes filles je l’ai tuerai, je suis pour la loi du talion
courage à vous et battez vous pour qu’il soit condamné
le 20 octobre, 2017 à 19 h 03 min a dit :
Je salue ton courage car il en faut pour dire et dénoncer ces agissements surtout lorsqu’ils viennent de personnes aussi haut placé.Ton texte m’a ému aux larmes car il a fait écho en moi.
J’ai fais un petit post facebook sur #metoo mais je n’ai pas pu aborder le principal. Je t’avoue que ces derniers jours à lire toutes les déclarations, j’ai hésité – parfois été à deux doigts de tout balancé, mais mes parents n’étant pas au courant, les faits étant assez graves et remontant à presque 15 ans je suis vraiment partagée entre la colère qui m’habite et la peur de susciter de la déception autour de moi. Je pense que la seule chose qui m’ai retenu c’est que mon père l’aurait découvert et j’ai peur que cela le blesse. Je sais que je suis la victime, mais j’ai peur de faire du mal à ma famille si elle découvre ce que je leur cache, qu’il éprouvent de la culpabilité à ne pas avoir su me protéger, à ne pas avoir su ce qui s’est passé pendant 1 an et demi derrière la porte de ma chambre avec une personne que ma famille pensait être mon ami (d’ailleurs c’est pour cela que je n’avais pas porté plainte lorsque j’en avais parlé à mon petit-ami de l’époque). Avec ce scandale, je ne peux que penser à ce garçon et je me demande de s’il pense à moi et à ce qu’il m’a fait à cette époque… J’espère aujourd’hui qu’il éprouve un minimum de culpabilité.
le 20 octobre, 2017 à 19 h 08 min a dit :
Bonjour,
Je viens de voir ton témoignage sur TMC.
J’admire ton courage, j’aurais aimé en avoir autant.
Comme toi j’ai aussi subit deux agressions dans ma jeunesse.
Mais il y a un sujet dont on ne parle assez, c’est lorsque les femmes vont porter plainte.
J’ai essayé de le faire pour ma deuxième agression. Après un long moment d’hésitation j’ai trouvé assez de courage pour pousser la porte d’un commissariat. J’ai alors subit plus un interrogatoire qu une prise de déposition avec des questions inquisitrices (comme exemple qu’elle était votre comportement, votre attitude comment étiez vous habillé, pensez vous avoir eu des mots ou des gestes qui aurait induit le comportement de votre agresseur…).
Malheureusement pour moi cette plainte n’a jamais aboutit car un mois après j’ai reçu un appel d’un policier me disant que ma plainte n’etait pas recevable car il y a des erreurs et que je devais revenir en déposer une nouvelle. Je n’ai pas eu le courage de retourner dans ce commissariat pour revivre cette épreuve difficile.
Je voulais juste témoigner de cette difficulté qu’on les victimes d’agression de porter plainte car même si elles ont le courage de le faire le chemin est semé d’embûches.
Merci à toi et à toutes celles qui nous permettre d’ouvrir notre parole.
le 20 octobre, 2017 à 19 h 50 min a dit :
Bonjour Ariane,
Bravo pour votre témoignage !
Il m’a touché et vous pourrez lire ici ce qu’il m’a inspiré :
https://shiatsuki.net/moiaussi-nousaussi-messieurs/
Continuons le travail.
le 20 octobre, 2017 à 21 h 15 min a dit :
Je suis bouleversée après la lecture de ton récit certainement parce que je retrouve ce malaise, cette peur que je connais bien #MoiAussi
le 20 octobre, 2017 à 21 h 53 min a dit :
Bonjour Ariane. Bravo à vous de participer à libérer les paroles. C’est très bien car vous avez la chance d’avoir une visibilité médiatique que d’autres n’auront pas. Il faut donc des témoignages comme le votre pour crever l’abcès. C’est d’autant plus courageux pour vous et d’autres car vous courrez le risque de la triple peine en nommant la personne, après l’agression en elle-même, la souffrance psychologique ensuite, et l’éventuel procès en diffamation de la part de votre agresseur. Si cela permet à plein de femmes de prendre conscience qu’il ne faut plus avoir peur de crier à l’agression au moment voulu, et à faire prendre conscience aux hommes que l’impunité c’est fini (et donc diminuer le nombre d’agressions), alors ce sera gagné.
le 20 octobre, 2017 à 22 h 02 min a dit :
Bonsoir Ariane,
Jeune femme de 33 ans issue d’un milieu privilégié, j’ai également subi une agression similaire dans le métro ainsi qu’un viol de la part de quelqu’un en qui j’avais une totale confiance, ami depuis plus de 10 ans et qui a abusé de ma faiblesse à la fin d’une soirée alcoolisée. J’ai pensé à porter plainte mais la honte, la peur de ne pas être crue, de l’exposition que ça allait engendrer et de blesser mes proches m’ont fait reculer. Merci d’avoir eu le courage que je n’ai pas eu. #moiaussi
le 21 octobre, 2017 à 0 h 49 min a dit :
Merci Ariane de dire avec les mots justes ce que nous ressentons. C’est dur d’en parler, le #moiaussi est dur à écrire, je n’ai pas réussi… ton témoignage et ton combat aident beaucoup de femmes, moi ils m’aident! Merci!
le 21 octobre, 2017 à 5 h 22 min a dit :
[…] un post intitulé « #moiaussi : pour que la honte change de camp » publié jeudi sur son blog, Ariane Fornia (Alexandra Besson de son vrai nom) raconte plusieurs agressions sexuelles dont elle […]
le 21 octobre, 2017 à 7 h 55 min a dit :
[…] y a trois jours, j’ai posté sur ce blog un article intitulé #moiaussi dans lequel je témoignais de trois agressions sexuelles que j’ai subies entre l’âge de treize […]
le 21 octobre, 2017 à 8 h 22 min a dit :
Bonjour,
je reviens sur ce passage dans le témoignage un peu plus haut, de Heather Lewis :
“Ce type de crime tue la vie dans la vie. On porte cette honte chaque jour. Que l’on soit homme ou femme ce type d’agression reste incrusté sa vie durant. Espérance de vie en France : plus de 80 ans. Les victimes portent cette douleur toute leur vie. Pourquoi les agresseurs bénéficieraient-ils d’une date de péremption ? Au nom de quelle « humanité », eux qui en sont exempts ? Jusqu’au dernier jour de leurs vies, on devrait pouvoir les poursuivre, les mettre face à leur(s) crime(s). Il est déjà si difficile de dire cette honte mal placée lorsque l’on lutte avec, et eux devraient pouvoir passer l’éponge au bout d’un certain temps ? Où est la notion de justice ?”
Moi parmi d’autres victimes : vie détruite (moments éprouvants dans la vie, échecs études/ travail/vie perso/ rejets/incompréhensions, dépressions, SDF, esseulée, vie de couple possible mais difficile seulement à partir de fin 40aine, statut handicap, retraite de misère… tandis que le coupable -dcd- a bien vécu, bien bossé, avec une retraite bien méritée….). Pas de haine. Mais c’est vrai, le schéma des enfants victimes trop gravement atteints est une condamnation à vie. A 60 ans, même si je m’accroche pour paraître toujours 10 ou 15 ans de moins, pour rattraper du temps, reconstruite trop tardivement fin40aine, tout est décalé : comment recommencer sa vie, comment ne pas être amère quand rien n’a pu être réalisé ? Alors je me console : il y a pire, il y a bien pire sur cette terre. Et Dieu merci, j’aime la nature, les randos avec mon mari.
Merci
le 21 octobre, 2017 à 8 h 45 min a dit :
Bonjour Ariane
Il faut savoir que depuis la fin des années 70
la France a mis en place de veritables réseaux pedocriminels
internationaux….
pour vous en convaincre vous pouvez visiter
1)mon site web
http://www.amandine-lopez.xyz/
2)ma chaine Youtube
yanlop777
3)ma page facebook
https://www.facebook.com/yanlop
4)La page facebook consacrée a ma fille
https://www.facebook.com/amandineLopez210/
En se moment il y a un enorme scandale qui fait surface
un petit garçon de 5an 1/2 violé par les élites Françaises
sur la base militaire du mont Verdun près de Lyon
et au grand orient (franc-Maçonnerie)
Plus d’infos ICI:
https://www.youtube.com/watch?v=lhZMvUQEvx4&list=PLdzzIS2C5lwztqhudgLll5M4NRj6FRZRZ
https://www.facebook.com/AmorisSeverine/
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2017/10/01/35726630.html
Courage a toi pour ton combat
YAN
le 21 octobre, 2017 à 10 h 06 min a dit :
Bonjour! Je vous découvre via cette déferlante médiatique et je suis impressionnée par votre courage et la justesse de votre parole! Bravo! Courage pour les possibles évènements médiatiques difficiles à venir, vous allez devoir continuer à vous défendre, mais nous pensons à vous et sommes avec vous! Je veux lire vos livres à présent. Merci!
/Lisa, (féministe expatriée en Suède, pays réellement plus juste pour les femmes).
le 21 octobre, 2017 à 12 h 31 min a dit :
[…] plus connue sous son nom d’auteur Ariane Fornia, a publié un billet de blog intitulé «#Moiaussi: pour que la honte change de camp» qui fait l’effet d’une bombe. Dans la foulée de l’affaire Harvey Weinstein ainsi […]
le 21 octobre, 2017 à 12 h 43 min a dit :
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/agressions-sexuelles-un-amendement-rejete-par-les-deputes_1808421.html
en 2016 …seulement 15 députés sur 577 avaient voté, sur les 15 il n’y avait que 6 députés qui votaient pour l’inéligibilité des députés coupables de harcèlement, ça en dit long sur les politiques…
en 2017 les sénateurs condamnaient les harceleurs tout en sachant que peu de harceleurs sont condamnés, voilà pourquoi il faut parler…
http://www.lepoint.fr/politique/harcelement-sexuel-le-senat-vote-l-ineligibilite-des-elus-condamnes-11-07-2017-2142376_20.php#
le 21 octobre, 2017 à 12 h 56 min a dit :
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/agressions-sexuelles-un-amendement-rejete-par-les-deputes_1808421.html
juste pour vous signaler que Noel Mamere et Cécile Duflot à l’origine de ce texte , qui était une très bonne initiative, n’ont même pas voté leur texte!!!
le 21 octobre, 2017 à 13 h 12 min a dit :
Je te crois. Même si ce porc dément, et va peut être mener cette affaire en justice, moi je te crois.
Je ne te connais pas mais je te crois.
le 21 octobre, 2017 à 13 h 16 min a dit :
Sofie Peeters est une jeune étudiante vivant à Bruxelles. Pour rendre compte du sexisme ordinaire existant dans la capital belge, elle réalise ” femme de la rue”, un web-documentaire réalisé en caméra caché dans les rues du quartier Anneessens, à Bruxelles. “Chienne”, “salope”.
http://www.marieclaire.fr/,sofie-peeters-femme-de-la-rue-bruxelles,696077.asp
le 21 octobre, 2017 à 13 h 17 min a dit :
<3<3<3<3
le 21 octobre, 2017 à 13 h 34 min a dit :
camera cachée harcelement de rue sur Paris et environ dans envoyé spécial
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8inUP90fI
le 21 octobre, 2017 à 18 h 36 min a dit :
Je vous ai connue adolescente, lorsque vous avez publié votre livre “Dieu est une femme”. J’étais un peu plus jeune que vous, et je m’étais bien marrée en lisant votre bouquin : je m’y étais reconnue, en tant qu’apprentie écrivaine, nulle en maths et pétrie d’ennui par le collège, moi aussi.
Je vous ai ensuite suivie sur votre ancien blog, dont j’aimais les articles finement écrits, avant de vous “perdre” de vue. Et je vous retrouve hier soir sur le plateau de Quotidien, lorsque vous avez témoigné des agressions que vous avez subies. J’aurais aimé entendre à nouveau parler de vous dans d’autres circonstances que celles-ci, mais peu importe : je tenais à vous dire merci pour votre témoignage, merci d’avoir parlé. Vous avez eu entièrement raison.
J’espère que votre agresseur, celui qui menace de vous attaquer pour diffamation, ressent enfin toute la HONTE qu’il aurait dû ressentir depuis des années.
Je vais continuer à vous suivre, j’ai tout votre blog à découvrir à présent. En tant que passionnée de voyages, j’en suis ravie 🙂
Bonne continuation à vous, et plein de belles choses.
le 22 octobre, 2017 à 21 h 14 min a dit :
Bonjour Ariane,
Je suis française et canadienne. Je crois que nous avons toutes une histoire similaire à raconter. Le problème ce sont nos valeurs de société qui font la promotion d’un certain aspect de l’être humain au détriment de tous les autres. Je viens tout juste de publier un ouvrage issu de trente années de recherche: Homme…Femme…un Nouveau Regard. Le communiqué de presse est sur le site http://www.arianepage.info. Si cela t’intéresse, laisse-moi savoir. Il faut un nombre maximum de femmes qui s’éveillent et fasse pression sociale pour que les hommes changent ce qu’ils ont entre les deux oreilles. Dans mon bouquin j’explique d’où vient le problème, bien inscrit dans l’évolution du cerveau. La libération de la femme, on le voit maintenant passe par les cerveaux masculins. Je montre la source de l’erreur : méprise sur l personne de la femme. Et cette méprise est multipliée par les médias et malheureusement par une ignorance généralisée de la différence féminine. Au plaisir de te lire et bravo pour ton courage! Ariane
le 24 octobre, 2017 à 22 h 06 min a dit :
https://fr.yahoo.com/news/fr%C3%A9d%C3%A9rique-bel-avoue-avoir-%C3%A9t%C3%A9-143756418.html
très bon témoignage de frederique Bel
le 25 octobre, 2017 à 10 h 18 min a dit :
Et que dire du “devoir conjugal” ? Devoir ? Où est l’amour là dedans ?
#moiaussi et bien avant d’être “casée”.
le 26 octobre, 2017 à 15 h 34 min a dit :
Moi je suis née à Brossard d une famille de 7enfants , étant la 6 j ai vécu une ouragan d émotions., de 1972 à 1975 j ai subit des agressions sexuelle venant du frère de ma mère . Étant sous la menace de l innocence les abus de l abuseur était
le 29 octobre, 2017 à 16 h 03 min a dit :
Je rajoute ce commentaire qui redira certainement la même chose que tous les autres mais merci pour ton courage, merci d’avoir partagé cette réflexion et merci de trouver les mots qu’il faut pour cette chose qui ne devrait pas exister. Cela me fait réaliser qu’au final il n’y a pas d’échelle au harcèlement ou à l’agression sexuelle. Certains agissements qu’on pourrait trouver “normaux” ne le sont pas. Nous sommes acteur du changement. #moiaussi
Clémence
le 30 octobre, 2017 à 20 h 29 min a dit :
Ton texte est poignant Alexandra. Ces témoignages sont révoltants et c’est vraiment écœurant de savoir qu’ils sont aussi nombreux pour beaucoup d’entre nous. Comment ces hommes ont-ils réussi à s’en tirer pendant aussi longtemps ? Et surtout comment peut-on se sentir coupable lorsque ce genre de pervers nous tombe dessus ? Ça me fait mal au cœur… !
Bravo à toi en tout cas et à toutes les autres qui osent dénoncer ces actes répugnants !
le 3 novembre, 2017 à 16 h 24 min a dit :
Bravo à toi pour ce texte. Avec toute ma sororité
le 6 novembre, 2017 à 12 h 46 min a dit :
Bonjour,
Merci de votre témoignage et bravo pour votre courage.
Votre exposition médiatique ainsi que celle de votre agresseur permettent de véritablement démontrer l’omniprésence ce fléau.
En tant que papa d’une petite fille de 2 ans j’espère vivement que la mise en lumière à laquelle nous assistons actuellement aura un effet durable et profond sur les mentalités. Et je regrette de ne pas voir suffisamment de réactions masculines sur ce sujet.
Encore désolé pour ce qui vous est arrivé et encore et encore merci pour votre courage.
le 6 novembre, 2017 à 16 h 37 min a dit :
Je suis venu ici suite à l’article du Monde qui dévoile l’identité de votre agresseur, dans la troisième agression dont vous parlez. Quel que soit l’article de société de ce journal, les commentaires des lecteurs sont souvent impulsifs et péremptoires: ici ça ne rate pas, encore une fois…mais l’accent est mis sur l’absence de preuve de l’agression, cette fois-ci. (argument qui m’a toujours choqué, même avant que je sois sensibilisé sur le sujet: l’accusatrice a tout à perdre et rien de clair à gagner).
Je voulais vous dire que je suis admiratif du courage de celles qui témoignent de ces agressions, niées ou minimisées par notre société. Je voudrais que les mentalités changent le plus vite possible à ce sujet, et je fais mon possible moi même pour être le meilleur allié possible dans cette sensibilisation, tout en m’efforçant de rester en retrait pour laisser la parole à celles qui en manquent cruellement. Merci pour votre post de blog!
le 7 novembre, 2017 à 13 h 38 min a dit :
[…] Besson, raconte cet épisode dans un billet de blog, posté le 18 octobre 2017 et intitulé «#MoiAussi: pour que la honte change de camp». En pleine affaire Weinstein, le texte fait mouche. Le récit de cette soirée à l'Opéra […]
le 7 novembre, 2017 à 15 h 47 min a dit :
[…] Dans un post de blog publié le 18 octobre et intitulé « #moiaussi: pour que la honte change de camp », l’auteure décrit une agression sexuelle par un « ancien ministre de Mitterrand », plus tard désigné comme Pierre Joxe, âgé de 82 ans aujourd’hui. Ce dernier a dénoncé dans une déclaration écrite transmise à l’AFP des « contradictions qui minent ce récit [et] le discréditent entièrement ». […]
le 7 novembre, 2017 à 16 h 08 min a dit :
[…] Pierre Joxe revenait sur le témoignage d’Ariana Fornia, qui l’avait accusée dans un post de blog de l’avoir agressé sexuellement à l’Opéra, et qualifiait le récit de […]
le 7 novembre, 2017 à 17 h 52 min a dit :
[…] décortique ainsi un post du blog de Ariane Fornia publié le 18 octobre et intitulé « #moiaussi : pour que la honte […]
le 8 novembre, 2017 à 11 h 45 min a dit :
Je suis désolée pour vous.
Moi aussi quand j’étais jeune… Mais pas seulement, et j’en ai encore envie de vomir.
L’an dernier alors que je me relevais à peine de chirurgies et traitements avec une invalidité et un handicap à la clef, je commençais à sortir un peu sur mes deux jambes mais sans rien pouvoir porter seule.
Lors d’un passage à la boulangerie de ce village dans lequel j’étais arrivée l’année précédente, un “voisin” apparemment bienveillant et connaissant très bien mes gros soucis de santé et limites physiques, me propose de porter mon sac et de me ramener chez moi avec sa voiture à l’autre bout de ce minuscule village dont il est natif, où tout le monde se connaît et dans lequel il occupe des fonctions que l’on peut appeler publiques depuis sa retraite.
Afin de le remercier (vu mon état de l’époque c’était vraiment un très grand service qu’il m’avait rendu), poliment je lui propose un apéritif qu’il accepte.
Après s’être affalé sur mon canapé en me disant que je n’arriverai pas à m’en sortir seule et qu’il pouvait tout pour moi, après qu’il m’ait déclaré qu’il était depuis mon arrivée attiré par moi, j’ai poliment répondu que je félicitais son courage de me dire cela mais que je préférais rester seule, que je n’étais pas attirée par lui et que rien n’étais envisageable.
Il a saisi mes poignets en me faisant très mal et je lui ai dit qu’il me faisait mal, je lui ai dit de me lâcher en me dégageant malgré les douleurs insupportables de ma maladie orpheline auto immune neuromusculaire et osseuse.
Il a de nouveau saisi cette fois-ci mes avant-bras dont il a subsisté pendant 4 jours les traces de ses doigts dégoûtants.
J’ai tenté de me dégager mais il a tiré fort et j’ai eu l’impression que mon coude se déboîtait.
Quand je lui ai redit que je voulais qu’il me lâche, qu’il me faisait mal et que je voulais qu’il parte de chez moi, il regardé sa montre et m’a répondu : “non, il est trop tôt je reste encore au moins une heure”.
Je lui ai dit : je suis ici chez moi et chez moi je suis seule à décider de ce qui s’y passe.
A cela il m’a répondu qu’il partirait seulement à la condition que je l’embrasse.
J’étais pétrifiée, pendant tout cet échange il en me lâchais pas le bras en pressant. Il puait mais là n’est pas la question, car quel que soit l’interlocuteur, quand on dit non plusieurs fois cela ne laisse pas de doute au fait qu’on refuse catégoriquement un contact quel qu’il soit.
Quand j’ai réussi à nouveau à me dégager il m’a fait part qu’il connaissait beaucoup de monde auprès des élus et jusqu’au conseil départemental.
Je l’ai attiré vers la sortie.
Il faut savoir que quand je l’ai fait entrer chez moi, j’avais ouvert toutes les fenêtres et laissé ma porte ouverte, cela ne l’a même pas incité à de la vigilance. Il était sur de lui, il était certain que rien ne pouvait lui arriver. J’étais selon lui : sa proie, sa chose, son “dû” puisqu’il avait porté mes courses…
Devant la porte de mon escalier, il m’a tiré vers lui pour poser sa bouche sur la mienne, j’avais envie de vomir et mon instinct m’a incité à ne rien dire puisqu’il allait enfin sortir de chez moi.
Je lui redit que cela me déplaisait, que je ne le voulais pas, je lui ai dit qu’il ne m’attirait ni physiquement, ni sentimentalement, ni intellectuellement. …Je ne pouvais pas être plus claire… Rien ne l’a arrêté, il prenait sans entendre, sans écouter.
Avant cela j’allais prier à l’église, mais il est le “gardien/guide” de l’église. Il m’a dit qu’il savait bien que si je venais à l’église c’était pour lui, pour le voir. Je lui ai dit que je venais à l’église pour prier et être en paix, rien à voir avec lui…. Je ne vais plus à l’église, je ne fais même plus mon petit tour dans cette partie si belle du village. Je ne veux plus croiser cette chose immonde.
La nuit qui a suivi il m’a téléphoner plusieurs fois (il avait récupéré mon numéro lors d’une réunion associative à laquelle j’avais participé pour tenter de m’intégrer dans le village… depuis j’ai quitté toutes les associations pour ne pas le croiser).
A la suite de ses appels en pleine nuit qui ont suivi son agression, épuisée par son harcèlement continuel, je l’ai rappelé pour lui redire qu’il ne m’attirait pas, qu’il ne m’attirerai jamais, que je n’ai pas du tout apprécié qu’il me force en faisant mal, qu’il m’avait pris moins d’une heure bien plus que “sa part” jusqu’à la fin de ses jours.
Je lui ai dit aussi qu’il n’avait plus aucune permission de poser ne serait-ce que les yeux sur moi. Qu’il lui était interdit de m’adresser la parole et de me saluer. Je lui ai dit qu’il était moins que rien à mes yeux, ni humain, ni bête. Je me suis autorisée à lui dire combien son odeur était insupportable pour quiconque le croise dans le village et que je le considérais comme “un porc au QI de moule”.
Je l’ai menacé de représailles s’il lui venait à l’esprit de tenter à nouveau quoi que ce soit, même un regard.
…Il faut être vraiment dérangé mentalement au plus haut point pour s’attaquer à une personne dont on sait que ses limites physiques ne lui permettront pas de se défendre normalement.
Je suis un mélange de hurlement intérieur, de colère contenue, de rage et il ne se passe pas un jour depuis sans que je ne rêve de lui envoyer un genoux “valide” bien placé…. Mais il savait bien que je n’avais pas cette capacité physique.
C’est un malade, un prédateur, un vrai danger qui ne doute de rien avec un ego démesuré et des relations.
Je suis écœurée. Cela fait un an que je pense à déménager et partir du village puisque je n’ose plus me balader seule dans certains endroits.
Courage à toutes…
le 12 novembre, 2017 à 12 h 28 min a dit :
Je suis tellement horrifiée, triste et désolée de lire cela. De tout coeur avec vous. Courage
le 9 novembre, 2017 à 5 h 34 min a dit :
Moi aussi J’ai été abuser psychologiquement, connotation sexuelle.J’ai 70 ans. Dénoncée
.
le 1 décembre, 2017 à 18 h 27 min a dit :
Coucou…
C’est bête, mais j’avais déjà vu ton article en flânant sur ton blog il y a quelques jours, et je ne l’avais pas ouvert, parce que ce n’était pas ce que je cherchais à ce moment là… Je cherchais le voyage; l’évasion, les récits d’aventures au bout du monde. Mais plus je te lis, plus j’ai envie de te connaître, et ce soir j’ai lu avec attention ton témoignage. C’est à la fois touchant, sincère, et glaçant. Je ne m’attendais pas à une telle émotion en te lisant; ces faits que tu décris, semblent à la fois terrifiants et pourtant j’en ai connus de similaires. C’est un point commun que j’aurais souhaité ne pas partager avec toi ! Quoi qu’il en soit, il faut beaucoup de courage pour se livrer comme tu le fais, et je ne peux que saluer ta démarche de dénoncer ce que tu as vécu, qui peut faire écho chez chacun d’entre nous. A aucun moment, tu n’as été fautive de quoi que ce soit, et c’est peut-être ça le pire, ce sentiment de culpabilité, qui se faufile insidieusement comme pour expliquer, donner sens à ce qui s’est passé, alors qu’il n’y a aucun sens à cela, ni aucune justification valable !
Tu sais, je travaille avec des adolescents, dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, avec des jeunes écorchés par la vie, et c’est un travail quotidien que de les amener à une estime d’eux-mêmes et des autres; et cela passe aussi par une réflexion sur les relations entre les hommes et les femmes. Je suis parfois (souvent ?) révoltée et sidérée par leur façon d’appréhender les choses, de reproduire ce qu’ils ont vécu. Mais j’ai l’intime conviction que c’est essentiel de les amener à réfléchir sur ce sujet. Et c’est aussi essentiel d’amener ces réflexions chez les plus jeunes, car c’est dans les cours d’école et de collège que tout commence…
Bref, merci pour ce témoignage sincère et touchant ♥
A bientôt !
le 12 décembre, 2017 à 0 h 29 min a dit :
Tout d’abord ma chère, votre texte m’a émue.. Tant de vérités et malheureusement tant de lâcheté de la part de ces hommes, qui parfois ne considèrent même pas leurs actes comme des délits passibles d’emprisonnement, initialement. Et aujourd’hui c’est grâce à vous que j’ose aussi parce que #MoiAussi : C’était l’été, j’avais déjà vécue des petites agressions, vous savez celles dont on ne parle même plus tellement cela devient quotidien. Je suis sortie à minuit pour aller me chercher un paquet de cigarette à même pas 5 minutes de mon domicile, j’étais d’ailleurs au téléphone avec mon chéri quand l’agression a commencée. Des mecs en voiture s’arrêtent près de moi, un d’eux me demande mon numéro de téléphone une première fois. Je ne réponds pas. La voiture redémarre, fait un tour et revient à moi, je décide de raccrocher, j’entre dans l’épicerie et j’en sors. Je m’allume une cigarette. Je décide de reprendre la route et me remets à marcher quand là, je vois la voiture revenir. Une nouvelle fois on me demande mon numéro, je dis non. Ils ont faisaient des tours et revenaient jusque moi jusqu’au moment où dans une rue tranquille l’un d’entre eux ouvre la fenêtre, me balance de l’essence. Je me mets à courir parce que je sens l’essence dégouliné sur tout mon visage, mes cheveux et mon buste. Je panique. Puis de nul part ils refont surface une dernière fois et cette fois-ci ils sont déterminés à m’immolée vivante, ils jettent du feu sur ma direction, heureusement j’ai eue le réflexe de me cacher sous une voiture. Ils repartent et me crient de bon coeur un “BONNE SOIREE SALOPE” . J’ai couru chez moi, en pleurs.. hébétée part la situation j’ai été dans l’impossibilité de fournir la plaque d’immatriculation précise de mes agresseurs.
Autre agression, verbal cette fois-ci, car je ne lui ait pas laissé le temps.
Un homme qui habite près de mon domicile me faisait toujours des compliments, etc. Jusqu’au jour où je me retrouve à 23h dans la même rue sombre que lui. Là, il m’a dit “Tu m’suces alors où quoi?” J’ai commencé à lui hurlé dessus et j’ai fuis.
le 12 décembre, 2017 à 13 h 36 min a dit :
Votre récit m’a horrifiée… de tout coeur avec vous, ce que vous avez subi est insoutenable et je suis tellement choquée de lire ceci. Vous êtes forte et courageuse. Je vous souhaite le meilleur. De tout coeur avec vous.
le 17 janvier, 2018 à 15 h 42 min a dit :
Bonjour et bravo pour avoir le courage de dénoncer des agissements aussi immondes.
J’ai lu la plupart des témoignages écrits ici et ils m’ont rendue malade… Comme beaucoup de femmes, j’ai subi des agressions et du harcèlement. Très jeune, je me suis rendu compte que certains hommes avaient des comportements odieux. J’en cite quelques uns ci-dessous, mais il y en a tellement plus (main aux fesses, blagues lourdes et commentaires déplacés de collègues, harcèlement de rue, etc.).
– J’ai 7-8 ans, j’attends ma mère à la sortie de l’école. Un type que nous avions croisé quelques jours auparavant et qui avait donné un coup de main à ma mère avec sa voiture, me parle gentiment. Il me met en confiance et au bout d’un moment me demande l’embrasser sur la joue.
Je suis sur le point de le faire mais je me souviens des recommendations de mes parents et d’une anecdote terrible racontée par ma grand-mère, si bien que je recule et je dis non. Il s’étonne et me demande pourquoi. Je lui réponds “je te connais pas”. Son visage change et devient dur et méchant. Il me répond sur un ton menaçant en pointant son doigt vers moi “tu me connais pas? Et bien, tu vas apprendre à me connaître”.
Je prends peur et je pars. Bizarrement, j’ai eu honte (allez savoir de quoi?) mais j’ai réussi à en parler quelques heures après à ma mère.
– j’ai 13 ans. Je suis dans un magasin avec ma mère. Je me retrouve seule dans un rayon et j’entends subitement une voix me susurrer dans l’oreille que je suis belle avec ma jupe. Je me tourne et je vois tout près de moi un type d’une quarantaine d’années avec un regard et un sourire malsains. Il commence à me parler et je m’en vais. Je ne l’écoute pas. Mais il me suit dans les rayons pendant que je cherche ma mère. Je la retrouve alors qu’elle se dirige vers la caisse. Il me suit jusque là. Il est juste derrière nous!! Il n’a pas peur. Et non, il sait que je n’oserai rien dire. Il continue de me sourire et je le foudroie du regard. 1 heure plus tard, alors que ma mère et moi rentrons en voiture, on le voit sur le bord de la route. Il me reconnaît et fait un geste de la main avec un sourire victorieux pour me saluer. Ma mère s’étonne et ne comprend pas ce qu’il veut. Je sors la main et lui fais un doigt d’honneur le plus dicrètement possible (encore une fois, comme si j’étais en tort).
– J’ai 26 ans. Je vis dans le centre et je rentre à pieds la nuit pour rentrer chez moi. Une première voiture pleine de mecs passe à côté de moi. Ils baissent la vitre et me traitent de salope. Je continue mon chemin. Une autre voiture passe avec un vieux dedans. Je trouve son regard bizarre. Il ne m’inspire pas du tout celui-là. je continue de marcher. Une centaine de mètres plus loin, j’arrive à un croisement et je m’apprête à traverser sur le passage pour piétons. L’autre imbécile dans sa voiture arrive sur ma gauche. Il a visiblement fait le tour du pâté de maisons pour me retrouver. Il s’arrête pour me laisser passer. Je traverse et à ce moment-là il appuie sur l’accélérateur avec un sourire. Je pique une crise de rage, l’insulte en levant en l’air les bras tout en continuant de traverser. Il est stupéfait le temps d’une minute et ensuite m’insulte. Il s’en va.
– J’ai 35 ans. Je vais consulter un médecin que je connais depuis quelques mois. Il me fait revenir tous les mois pour des contrôles. Je commence à m’impatienter, mais je lui fais confiance. Il est chaleureux et semble très professionnel. Ce jour-là, il se trouve que j’ai un début de bronchite et que j’ai affreusement mal aux côtes à force de tousser. Il me propose de m’examiner. Il en profitera pour me tripoter les seins. J’étais pétrifiée. Comme son attitude était très ambigue, qu’il faisait exprès de mélanger gestes médicaux et attouchements, je suis restée interdite, incapable de réagir… Après la consultation, il me propose de boire un pot. Je décline deux fois. Il me contacte ensuite par SMS en trouvant un prétexte bidon et m’appelle ensuite et me laisse un message, parce que je ne lui réponds.
Je rentre chez moi avec son odeur sur moi tellement il m’a collée. Je suis donc obligée de me laver pour virer son odeur.
Je n’en ai pas dormi pendant deux jours. Je me suis sentie coupable de n’avoir rien dit sur le coup et surtout de ne pas lui avoir cassé la gueule. J’en ai parlé à plusieurs personnes et j’ai décidé de lui écrire un email pour lui dire ce que je pense de lui en précisant bien que je lui déconseillais de me répondre. Par la suite, j’en ai parlé avec un médecin du centre où il travaille et j’ai déposé une plainte à l’Ordre des médecins, ainsi qu’auprès du directeur médical.
J’attends la suite et même si je suis encore révulsée par cette histoire qui est récente, je me sens beaucoup mieux depuis que j’ai fait le nécessaire.
Je crois que ce qui compte c’est de dénoncer ces agissements (quand c’est possible et qu’on a les noms bien sûr). Non seulement, ces types se sentent plus forts mais en plus, nous nous sentons encore plus mal si nous ne réagissons pas.
Il faut aussi éduquer certains hommes. Combien se targuent d’être des défenseurs des droits de la femme, mais vont prendre la mouche si vous essayez de leur expliquer certaines bases, comme par exemple: la séduction, la vraie, doit être plaisante pour les deux personnes! Par conséquent, sous prétexte que vous avez eu une relation avec eux, ça ne vous prive pas de votre droit de leur dire non et de refuser leur drague lourde.
Alors courage et ne baissez pas les bras!
le 25 janvier, 2018 à 22 h 31 min a dit :
De tout coeur avec vous… merci pour ce témoignage qui me retourne et m’émeut profondément.
le 24 mars, 2018 à 18 h 00 min a dit :
ne restez plus silencieuse, le coupable c’est lui et non vous..
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2242387-20180322-caen-cycliste-condamne-avoir-empoigne-fesses-etudiante?xtor=RSS-176
le 18 novembre, 2019 à 21 h 44 min a dit :
Chère Alexandra,
je relis votre billet en ce jour où vous avez affronté votre agresseur au tribunal. Ce doit être bien pénible de se retrouver sur le banc des accusées alors que l’on souhaitait simplement témoigner avoir été victime soi-même, participer à l’élan féministe #metoo. Je vous apporte tout mon soutien -lectrice de Mediapart, j’avais été scandalisée par le soutien apporté par Edwy Plenel à votre agresseur. Je lui ai écrit pour lui dire ma pensée. J’attends toujours des excuses de sa part.
Je vous crois sans aucune réserve, pour chacune des agressions que vous racontez. Je vous croyais déjà quand j’avais lu votre histoire il y a deux ans, et je vous crois toujours. Et je suis sûre que, comme moi, des milliers de femmes vous croient sans réserve.
Je suis admirative de votre courage et reconnaissante pour votre témoignage, qui me touche particulièrement parce qu’il exprime à quel point les agressions peuvent être invraisemblables, au point qu’elles laissent, en premier lieu, les victimes complètement sidérées. Et parce que comme vous le dites, si vous avez été agressée en pareilles circonstances, malheureusement, cela peut arriver à n’importe qui.
Entre mes 6 et mes 25 ans, j’ai subi plusieurs agressions sexuelles. Il a fallu #metoo pour que je prenne conscience de leur nombre et de leur véritable nature (e.g. une main aux fesses de la part d’un collègue, lors d’une soirée : c’était bien une agression sexuelle). Chacune m’a pétrifiée, comme vous le racontez vous-même. La dernière a eu lieu dans un cinéma où je m’étais rendue seule, pour fêter le premier jour de ma thèse. Elle me fait un peu penser à la vôtre : j’ai d’abord pensé que le type s’était endormi sur moi, puis, avec effort, je lui ai échappé, mais il a renouvelé ses assauts et je n’ai pas osé faire de scandale, parce que c’était la tempête dans mon crâne et que j’avais peur de faire du tort à un innocent (oui, je continuais de penser : il ne l’a peut-être pas fait exprès). Cette agression m’a traumatisée, m’a replongée dans ce que j’avais vécu enfant, et m’a poursuivie longtemps. Aujourd’hui, j’aimerais avoir la force, si j’étais à nouveau agressée un jour, de m’opposer fortement, de faire un scandale, de couvrir l’agresseur de honte. J’y travaille.
Quoi qu’il en soit : j’espère que vous gagnerez en justice et surtout que vous trouverez la paix après cette sale histoire. Encore merci pour votre témoignage, qui conforte l’ampleur de #metoo.
le 22 novembre, 2019 à 10 h 29 min a dit :
[…] en 2017, sa parole se libère, elle relate l’agression sexuelle dont elle se dit victime dans un billet de blog. Pierre Joxe est « stupéfait », nie en bloc, finit, en janvier 2018, par assigner la jeune […]
le 29 janvier, 2020 à 16 h 51 min a dit :
J’apprends que vous avez été condamnée pour diffamation. Je suis révoltée.
Moi, je vous crois.
Je veux vous aider, vous soutenir pendant le procès en appel. Comment ?
le 31 juillet, 2020 à 13 h 07 min a dit :
[…] #Moiaussi : pour que la honte change de camp – Itinera … Il est temps en effet que la honte change de camp, et que l’humanité entière honnisse ceux qui la rabaissent plus bas que des animaux. Ceux-là devraient être comme au moyen-âge être mis au pilori, désignés visage découvert au rejet de tous ceux qui, eux, ont gardé une âme, un coeur, un sens du respect de ce et ceux qui les entourent. […]
le 14 avril, 2021 à 14 h 39 min a dit :
[…] Ariane Fornia – de son vrai nom Alexandra Besson. La jeune femme avait publié un article sur son blog en 2017 dans lequel elle dénonçait les agissements d’un “ancien ministre de Mitterrand, […]
le 14 avril, 2021 à 14 h 40 min a dit :
[…] Ariane Fornia – de son vrai nom Alexandra Besson. La jeune femme avait publié un article sur son blog en 2017 dans lequel elle dénonçait les agissements d’un « ancien ministre de Mitterrand, membre […]
le 11 mai, 2022 à 16 h 52 min a dit :
[…] Fornia (de son vrai nom Alexandra Besson), fille d’Eric Besson, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, a publié un billet dans lequel elle affirmait avoir été victime d’agressions sexuelles dans sa jeunesse de la part […]
le 11 mai, 2022 à 17 h 12 min a dit :
[…] Fornia (real name Alexandra Besson), daughter of Eric Besson, former minister of Nicolas Sarkozy, posted a post in which she claimed to have been the victim of sexual assault in her youth by a “former […]
le 11 mai, 2022 à 18 h 32 min a dit :
[…] Fornia (de son vrai nom Alexandra Besson), fille d’Eric Besson, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, a publié un billet dans lequel elle affirmait avoir été victime d’agressions sexuelles dans sa jeunesse de la part […]
le 20 mai, 2022 à 17 h 23 min a dit :
[…] Fornia (de son vrai nom Alexandra Besson), fille d’Eric Besson, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, a publié un billet dans lequel elle affirmait avoir été victime d’agressions sexuelles dans sa jeunesse de la part […]